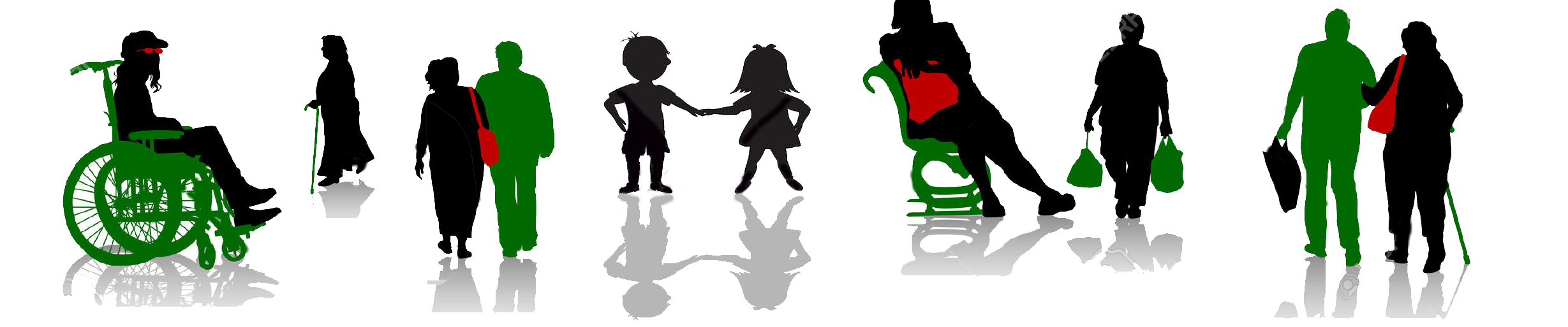ATELIER PRECARITE
QUAND L’USAGER EST AUX MARGES DE LA SOCIETE
Avec le témoignage enregistré d’Henri, qui a vécu une période de précarité, la participation à une réunion organisée par PLURIACT le 12 avril 2024, de Christophe BERTRAND, psychologue du travail à France Travail, Isabelle COUNIOUX et Thierry CORFMAT, bénévoles de l’Association Lausec (Felletin), Mireille DEPAULIS, professionnelle du médico-social à la retraite, Léo DUMIGNARD, chef de service d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et d’un Centre Auteur, Julia GIRY, infirmière au PASS, Permanence d’Accès aux Soins Santé dédiée à la grande précarité (Hôpital de Guéret), Claire GODEFROY, chef de service du 115/SIAO au Comité d’Accueil Creusois, Hervé GUILLAUMOT, médecin généraliste retraité, Sandrine LARDILLER, infirmière, membre de l’équipe mobile de précarité (secteur de Guéret), Rachid LEUCHI, éducateur au SIAO/115 du Comité d’Accueil Creusois, ainsi que des témoignages enregistrés de Christian DIABONE, CARSAT (Limoges), Lucile PERIOT, secrétaire générale du Secours populaire français (Creuse), Stéphane PRZYSIEZNA, président de Solidarité Entraide 23, Françoise TÊTE, infirmière ISBA. Alain MOLAS, animateur, membre de PLURIACT.
Rapport composé par Alain DEPAULIS et Sandrine LARDILLER à partir des échanges recueillis lors de la réunion du 12 avril 2024 et des témoignages individuels enregistrés.
* * *
Cet atelier a obtenu facilement la participation de bénévoles et de professionnels, ce ne fut pas le cas des personnes ayant vécu dans la précarité. Cette retenue témoigne de la blessure intime que représente un séjour dans la rue sans autre mode de survie que la mendicité. Nous sommes donc particulièrement reconnaissants à Henri d’avoir accepté de nous livrer sa douloureuse expérience. Nous avons recueilli les témoignages de professionnels (déposés sur le site www.pluriact.fr) dont nous présentons le parcours qui témoigne d’un authentique engagement humain, que certains avouent ne pas pouvoir assumer longtemps, tant il est affectivement et moralement épuisant. Ce sont des métiers qui ne laissent pas indemnes. Certains ont pu participer à la rencontre que nous avons organisée afin d’échanger leur expérience. Ce sont ces paroles d’un usager et de professionnels que nous livrons.
Les participants :
– Henri, âgé de 57 ans. Cet homme fragile a vécu protégé au domicile de son oncle et se trouve complètement démuni au décès de ce dernier. Commence pour lui une vie dans la rue. Henri a accepté que son témoignage soit enregistré et présenté lors de la réunion.
– Christophe BERTRAND, psychologue du travail à France Travail. Son but est d’aider les personnes en difficulté à retrouver un emploi en terme d’objectif. Son intervention vient en appui à ses collègues de la CPAM qui lui adressent des personnes pour un accès aux soins. C’est un travail qui nécessite la rencontre de partenaires tels que le CPRC (Centre de Proximité en Réhabilitation Psychosociale de la Creuse) ou les équipes mobiles (ISBA).
– Isabelle COUNIOUX et Thierry CORFMAT bénévoles de l’association LAUSEC (Local d’Accueil d’Urgence Sud Est Creuse) qui compte une quinzaine de membres, tous bénévoles, assurant un accueil d’urgence. Le groupe travaille de manière très étroite avec le 115/SIAO.
– Mireille DEPAULIS, retraitée, a travaillé dans le médicosocial et l’éducation. Elle a été membre du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) d’une petite commune rurale, où elle a assuré l’accompagnement de personnes en difficulté. Elle est membre de PLURIACT.
– Léo DUMIGNARD a travaillé durant 7 ans au Comité d’Accueil Creusois. Il est à présent chef de service d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et d’un Centre Auteur (qui travaille avec les auteurs de violences conjugales). Ce service intervient auprès de toutes personnes qui, a un moment de sa vie, n’a plus de toit. (Une réinsertion par le biais du logement suivie de recherches de réponses à toutes les problématiques que rencontre la personne).
– Julia GIRY,infirmière au PASS (Permanence d’Accès aux Soins Santé), en poste depuis 2020 au service d’accueil de la grande précarité à l’hôpital de Guéret. Le service prend en charge tous les patients qui n’ont pas de droits ouverts, une couverture partielle et toutes les personnes qui sont en situation de rupture de soins.
– Claire GODEFROY a exercé comme éducatrice spécialisée auprès d’enfants en situation de handicap. Elle travaille à présent dans le secteur de l’hébergement d’urgence et d’insertion, elle est chef de service du 115/SIAO au Comité d’Accueil Creusois. Elle est membre de Pluriact.
– Hervé GUILLAUMOT, au titre de médecin généraliste retraité, n’a pas un parcours spécifique par rapport au problème de précarité. Il a bien évidemment rencontré ce type de patient au cours de sa carrière. A noter qu’il a été maire de sa commune durant plusieurs années.
– Sandrine LARDILLER, infirmière en hôpital général et depuis 20 ans en milieu psychiatrique a rejoint l’équipe mobile de précarité. Depuis un an, elle intervient auprès des structures d’hébergement d’urgence. Son travail consiste à évaluer les besoins psychiques et déterminer les éventuelles orientations. Elle est membre de Pluriact.
– Rachid LEUCHI, éducateur au SIAO/115 (Comité d’Accueil Creusois). Il a débuté dans le social à l’âge de 24 ans, comme veilleur animateur puis comme éducateur. Il a exercé son métier le jour comme la nuit. Son service actuel s’occupe des mises à l’abri d’urgence. Une partie de ce travail consiste à amener les personnes à quitter la rue.
Témoignages enregistrés :
– Christian DIABONE, Carsat, opère sous l’égide du service social. Le Service Social de l’assurance maladie reçoit et accompagne les assurés sociaux du régime général et les travailleurs indépendants. Ce service opère à la fois pour les actifs et pour les retraités du régime général sur deux axes majeur d’intervention : la Prévention de la désinsertion professionnelle et la Sécurisation des parcours en santé.
– Lucile PERIOT, secrétaire générale du Secours populaire français (Creuse), a un parcours universitaire pluridisciplinaire et interculturel (Licence Langues Etrangères Appliquées, Master en Management Interculturel). Elle a débuté au Secours populaire en tant que stagiaire, puis bénévole sur des actions de solidarité internationale et d’accompagnement à la scolarité. Elle définit l’action du Secours populaire comme « généraliste de la solidarité ».
– Stéphane PRZYSIEZNA, président de Solidarité, Entraide 23, a exercé différents métiers avant de se consacré au bénévolat.
– Françoise TÊTE, infirmière à l’association ISBA Santé Prévention 23, elle assure l’accompagnement individualisé à la santé. Les personnes qui lui sont adressées sont souvent en situation de précarité, physique, morale ou financière et l’accès à la santé leur est difficile voire impossible. Son travail consiste à les accompagner dans leurs démarches de santé (prise de rdv, accompagnement physique aux rdv, visites à domicile, soutien psychologique, compréhension santé, prévention…).
Les services représentés :
– Association LAUSEC : Local d’Accueil d’Urgence du Sud-Est Creusois. Cette association offre un lieu d’accueil d’urgence situé sur un axe de passage à la porte du plateau de Millevaches. Elle dispense un toit, un repas et du repos. Une personne peut être hébergée pendant plusieurs mois moyennant une participation à la mesure de ses ressources (RSA le plus souvent). Cette personne doit être en recherche d’un logement et d’une formation. Une équipe de 12 à 15 bénévoles assure des permanences constantes. Ses membres participent aux rencontres organisées par le SIAO, facilitant les relations entre les différents acteurs du département.
– Association ISBA, Santé Prévention est une association loi 1901 (initialement Institut de Santé Bourgogne Auvergne) qui a pour but de promouvoir des actions de prévention contribuant à protéger et valoriser la santé. L’association dispose de 7 centres d’examen de santé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plupart de ces centres sont conventionnés avec les CPAM pour la réalisation des EPS (examen de prévention en santé, ex : bilan de santé) des personne en précarité. L’association a également pour mission l’accompagnement individualisé à la santé, mission créée en 1999 en Creuse, déployée à ce jour en Haute-Loire, Allier et Cantal. Elle concerne aujourd’hui les personnes qui ont perdu tout lien avec les services de santé. Cette action d’accompagnement est financée par l’ARS et le Conseil Départemental en Creuse. Les personnes qui lui sont adressées sont souvent en situation de précarité, physique, morale ou financière et l’accès à la santé leur est difficile voire impossible. Le but de l’intervention est de les aider à réaliser les démarches nécessaires, de mettre en place les outils nécessaires à leur accessibilité à la santé, et de les amener progressivement à être autonomes dans leurs parcours de soins.
– CARSAT Limoges (Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail). Le Service Social de l’assurance maladie reçoit et accompagne les assurés sociaux du régime général et les travailleurs indépendants. Il opère à la fois pour les actifs et pour les retraités du régime général sur deux axes majeur d’intervention. L’axe de « Sécurisation du parcours de santé » il s’agira d’accompagner l’assuré à lever tous les obstacles qui limitent son accès aux droits et /ou son accès aux soins. Et avec l’axe de « Prévention de la désinsertion professionnelle » il sera question par la lecture de sa trajectoire médicale de veiller à la fois à lui faire valoir des droits, à le guider dans le parcours administratif idoine, à évaluer les restrictions d’aptitudes subies et leurs impacts sur le métier exercé. Ces axes d’interventions s’inscrivent dans une perspective de gestion du risque avec comme paradigme de l’intervention sociale une action ciblée, anticipée tant que faire se peut pour limiter les effets délétères de la problématique sociale qui perturbe l’itinéraire « normé » de l’assuré. Ce qui constitue une démarche pro-active par laquelle ces professionnels se présentent à l’assuré sur détection de certains partenaires (Service médical notamment, Établissement de santé, ….)
– CCAS rural (Centre Communal d’Action Sociale), cette structure dépend du Conseil municipal donc du maire. Elle souffre d’être sous-estimée en milieu rural malgré son utilité. Par sa connaissance des administrés et du terrain elle permet en effet une articulation souple avec les services professionnels dédiés à la précarité.
– Centre Auteur, Centre de Prise en Charge des Auteur.e.s de violences conjugales. Le CPCA est un lieu d’échanges et de réflexion, ouvert à tous, personnes sous-main de justice ou volontaires souhaitant réaliser une démarche personnelle. Les accompagnements proposés sont gratuits à l’exception des stages.
– Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, le CHRS est un établissement chargé d’accompagner, au titre de l’aide sociale, des personnes isolées ou familles connaissant de graves difficultés d’ordre économique, familial, de logement, de santé et/ou d’insertion. L’objectif est de les aider à accéder ou recouvrer leur autonomie personnelle ou sociale, notamment en milieu ordinaire ou adapté (logement, emploi…) L’hébergement va de l’asile de nuit en situation d’urgence à la mise à disposition de logement de plus longue durée. L’action socio-éducative au sein de ces établissements se traduit par une prise en charge individualisée et globale par le biais d’un « projet d’insertion » élaboré avec la personne accueillie. Le service soutient l’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle. Les CHRS peuvent accueillir des personnes souffrant de problématiques spécifiques : femmes victimes de violence, jeunes, personnes placées sous-main de justice, personnes en parcours de sortie de la prostitution…
– L’Equipe mobile de précarité, est un dispositif de prévention destiné aux personnes en grande en grande précarité sociale et médicale, dont les difficultés les empêchent d’accéder aux soins, en raison d’une absence ou d’un refus de soin. Elle apporte un appui en termes de prise en charge en santé mentale. L’équipe a vocation à aller à la rencontre de personnes en situation d’isolement, d’exclusion afin de faciliter la prévention par un repérage précoce. L’objectif est d’accompagner les personnes afin qu’elles se réinscrivent dans un dispositif de droit commun, en assurant une fonction d’interface entre les secteurs de psychiatrie et les équipes sanitaires et sociales œuvrant dans le domaine de la lutte contre la précarité et l’exclusion. Ce service travaille en réseau autour du patient, il est le complément psychiatrie/santé mentale des Permanences d’accès aux soins santé (PASS).
– France Travail, anciennement Pôle Emploi, est le service officiel de la recherche d’emploi (diffusion du CV du demandeur, abonnement aux offres publiées et aux informations et services sur les allocations). Le service met en relation les demandeurs d’emploi avec les offres du marché, mais assure également une mission de liaison avec les services de santé et les services sociaux.
– Le Secours populaire, intervient auprès d’un public très large : familles monoparentales, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs pauvres, retraités, demandeurs d’asile, personnes en attente de régularisation, personnes hébergées au 115, familles nombreuses, personnes seules,… Les personnes sont le plus souvent orientées par un travailleur social (UTAS, Comité d’Accueil Creusois, CCAS, UDAF, Viltais, L’Escale,…) mais aussi par le bouche-à-oreille. En Creuse, 130 bénévoles apportent un soutien matériel aux personnes en situation de précarité. Au-delà de l’aide alimentaire, porte d’entrée, le SPF propose d’accompagner les personnes : aide aux devoirs pour les enfants, cours de français pour les migrants, stands d’information ou de prévention lors des distributions alimentaires (planning familial, ALURAD, Mois sans Tabac, Ligue contre le cancer,…), sorties vacances/culturelles/loisirs,… L’association agit également pour l’accès à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au sport, aux vacances,… Elle met également à disposition des vestiaires et des espaces brocante.
– Solidarité, Entraide 23, est une association qui présente un espace brocante à très bas prix destiné aux personnes nécessiteuses. L’association récupère tous types de dons, à l’exception de l’alimentaire, mais des vêtements, du mobilier, des livres, des jouets… Elle se propose également de vider des maisons. Les articles sont ensuite mis en vente au local de l’association.
– La PASS (Permanence d’Accès aux Soins Santé de l’Hôpital de Guéret), prend en charge tous les patients qui n’ont pas de droits ouverts, une couverture partielle (pas de complémentaire santé) et toutes les personnes en grande précarité induisant une absence ou une rupture de parcours de soins. Le service reçoit 90% de population étrangère car il travaille beaucoup avec les structures d’accueil pour les migrants (demandeurs d’asiles, mineurs non accompagnés, réfugiés). Les intervenants sociaux peuvent adresser également des personnes précaires ayant besoin d’une prise en charge médicale et/ou sociale (mettre en place ou rétablir des droits sociaux). Le service prend en charge toute la partie budget pour le soin au sein de l’hôpital de Guéret (médicaments, consultations avec spécialistes, consultations d’un généraliste les jeudis après-midis, examens divers). La PASS travaille avec l’Équipe Mobile de Précarité Psychiatrique pour la sphère psy. Et aussi beaucoup avec les différents services du Conseil Départemental (PMI, Centre Départemental de Vaccination, ASE). Prochainement des permanences pourraient être proposées régulièrement dans des associations d’aide aux personnes en difficultés.
– SIAO/115, Comité d’Accueil Creusois. Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation est un service phare, c’est la plate-forme de régulation du dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. Ces missions sont ainsi définies par le Ministère : « Le SIAO recense les demandes d’hébergement d’urgence ou d’insertion ainsi que de logement adapté ; Il recense l’offre disponible en matière d’hébergement d’urgence, de stabilisation ou d’insertion ainsi que de logement adapté ; Il veille à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale ou psychique ; Il assure une orientation des personnes vers la solution la plus adaptée à leurs besoins et en fonction de leur situation de détresse ; Il assure la gestion du service d’appel téléphonique 115 ; Il coordonne l’action des autres acteurs de la veille sociale (équipes mobiles, accueil de jour…) ; Il suit le parcours des personnes prises en charges jusqu’à la stabilisation de leur situation ; Il contribue à l’identification des personnes en demande d’un logement, si besoin avec un accompagnement social ; il participe à l’observation sociale. »
* * *
Précarité ?
Ainsi qu’en témoigne cette liste des services engagés dans notre réflexion, le champ d’action sociale concerné est très large. La notion de précarité ne recouvre donc pas la même réalité selon la mission du service. L’axe de « Prévention de la désinsertion professionnelle » soutenu par la CARSAT ou encore l’action de l’Association ISBA relèvent prioritairement de la prévention. En revanche, le SIAO ou le CHRS sont directement confrontés à une précarité avérée par des problèmes d’hébergement, de nourriture, de sécurité physique et psychique, nommée parfois « grande précarité ». Nous n’avons pas choisi de faire une hiérarchie du degré de gravité de la situation vécue dans la mesure où dans une période où le nombre de personnes en voie de précarisation s’accroît, nous ne voulons pas mésestimer les lieux où s’observe un décrochage des liens sociaux. Entre ces deux pôles un éventail d’espaces s’offre avec sa singularité qui constitue, peut-être, la meilleure présence humaine possible en réponse à ces personnes en voie de déliaison sociale.
Parler de précarité aujourd’hui appelle une remarque préliminaire : l’augmentation de personnes en situation précaire. L’association LAUSEC, composée de bénévoles, est à ce titre témoin de l’évolution de la population accueillie. Il y a quelques années, le local recevait ce que l’on nommait des routards, âgés parfois de 60 ans, coutumiers de pérégrination de local en local et qui ne manifestaient pas la détresse que l’on observe chez les personnes reçues à présent : ce sont surtout des personnes dans la quarantaine, victimes d’accidents de la vie, mais aussi de plus en plus de jeunes gens entre 25 et 30 ans. Par accidents de la vie il faut entendre la séparation familiale, la perte d’un emploi, la perte d’un logement liée à des difficultés financières, la perte du RSA… Des motifs qui affectent souvent des personnes fragiles qui le deviennent de plus en plus et qui se retrouvent dans la rue. A cela s’ajoute souvent la dépendance à toute sorte de produits qui génèrent des réactions inappropriées, difficiles à gérer pour des bénévoles, sans passé professionnel. Les troubles sont de plus en plus importants. Avec le COVID, les membres de l’association ont observé une majoration de l’isolement sur sentiment de peur et de méfiance. Ces personnes arrivent, elles sont fatiguées, il faut répondre à toutes leurs difficultés, en tenant compte de leur façon d’être. Il faut les aider à avoir les idées claires et un minimum de sérénité : « On a vu, constate Isabelle, une évolution des personnes en dérive dans leur situation et leur désordre mental. On ne sait jamais s’il faut faire appel à un service spécifique. » Le LAUSEC bénéficie heureusement d’échanges constants avec le 115. Dans les situations critiques ils ont également recours à la gendarmerie.
La précarité se décline sur plusieurs niveaux, précarité familiale, précarité financière, précarité du travail, précarité de santé, précarité de logement, précarité avec l’école, précarité énergétique. Les personnes marginalisées ont un manque de sécurité, par manque de moyens : avoir un toit, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir se chauffer… Les gens qui se sont retrouvés à la rue sont des gens qui ont eu des accidents de parcours, problèmes familiaux, des problèmes de travail et les addictions qui jouent un grand rôle. Une spirale que l’on peut exprimer ainsi : « j’ai des problèmes familiaux, j’ai des problèmes au travail, c’est des problèmes que je n’arrive plus à résoudre et pour oublier la réalité s’ajoutent les addictions et c’est le cercle infernal… » « Le point de rupture, précise Rachid, c’est la famille qui n’a pas pu ou su les protéger. » Le modèle familial n’a pas permis de se construire, d’avoir un travail. Il y a un manque d’étayage familial. Ainsi ne sont-ils plus en mesure d’affronter la société.
Le témoignage d’Henri est de ce pont de vue éloquent : « Je me suis retrouvé à la rue à la mort de mon oncle. Je vivais avec lui dans sa maison et à sa mort son fils adoptif a voulu reprendre la maison et m’a mis dehors. Je pensais au suicide mais mon oncle ne m’aurait jamais permis de faire ça. C’est cette pensée qui m’a empêché de passer à l’acte. Au SIAO, j’étais soulagé d’avoir un toit sur la tête pour dormir et pour manger. La première nuit, j’ai eu du mal à dormir. Au fur et à mesure, je me suis habitué. La journée, je restais à la gare et je regardais les gens et les trains passer. Et puis je suis retourné dans la rue. Je me suis senti rejeté. Je me sens rejeté par la société depuis que j’ai une trachéotomie. J’ai peur de parler aux gens. J’ai eu une trachéotomie en urgence et je me suis réveillé un jour avec un trou dans la gorge. Je n’ai pas compris et je l’ai très mal vécu. Mon oncle m’a soutenu durant cette période. A sa mort, plus rien n’avait d’importance donc je ne faisais plus rien. Je n’avais pas l’envie de faire les démarches. En plus, les gens ne me comprennent pas alors me présenter pour leur demander des justificatifs était difficile. Je m’en foutais. Je pense que j’étais dépressif. Je n’avais plus accès à mon compte-bancaire, j’ai dû faire la manche pour la première fois de ma vie et la nuit, je dormais sous le parking de Leclerc. Je dormais que d’un œil avec un couteau dans la poche pour me défendre au cas où. J’avais peur qu’on me tabasse et qu’on me vole. Je n’avais pas grand-chose : mon baluchon, ma montre, mes bijoux et un peu d’argent. Je faisais la manche tous les jours. Un soir, une dame a failli m’écraser avec sa voiture et elle a prévenu le vigile qui m’a viré. Les éducateurs du CHRS m’ont très bien accueilli et ont fait tout leur possible pour m’aider. D’ailleurs, je vais chercher le pain pour les aider. Pour moi, c’est très important de me sentir utile. Les éducateurs du 115 ont fait un chouette travail également. »
Le 115 et le CHRS reçoivent un public très éclectique depuis le bébé d’un mois à la personne de 80 ans… des personnes en migration, des personnes avec des troubles psychiques, des SDF, des jeunes sortants de l’ASE (Aide Sociale Enfance). Tous subissent une précarité financière, leur point commun est de ne plus avoir de toit sur la tête. « On reçoit des personnes qui ont des difficultés intellectuelles, des troubles psychiques, sur fond de problème économique ou de problème migratoire. A un moment ils se retrouvent à la rue. Ils perdent le lien avec leur famille, ils perdent le lien social. Ils décrochent des choses administratives. Ils perdent l’image de soi et sombrent dans la détresse. » Le PASS observe « tous les profils, toutes les cultures, toutes les religions avec tout ce que cela implique. En fonction de leur histoire, de leur situation actuelle, les patients ne gèreront pas les choses de la même manière. »
Plusieurs services assurent un rôle de prévention, ils sont en relation avec une population dans laquelle se constate la précarité, comme à ISBA lorsque l’accès à la santé devient difficile voire impossible : « Le but de mon intervention, dit Françoise, est d’amener les personnes accompagnées à renouer avec la santé, de les aider à réaliser les démarches nécessaires, de mettre en place tant que cela est possible les outils nécessaires à leur accessibilité à la santé, et de les amener progressivement à être autonomes face à leur parcours de soins. » Ou encore à la permanence du Secours populaire : « familles monoparentales, bénéficiaires des minima sociaux, travailleurs pauvres, retraités, demandeurs d’asile, personnes en attente de régularisation, personnes hébergées au 115, familles nombreuses, personnes seules,… » En revanche les interventions de la CARSAT relève d’un cadre dit normal, d’offre d’accompagnement à une personne qui est sensée pouvoir s’en saisir : « Vous avez une difficulté sociale dont on ignore l’impact réel, si vous l’admettez nous pouvons vous accompagner dans la compréhension de cet obstacle et dans votre recherche de solutions ». « Nous jugulons le fait « accidentel » qui vient frapper leur trajectoire de vie. » dit Christian. La mise à disposition permet à l’assuré de cheminer seul, d’affirmer la nécessité de son recours au service et donc d’agir en conséquence.
Par le public qu’il reçoit le PASS est un accès au réseau qui intervient auprès des personnes précaires. Le service prend en charge médicalement et socialement des personnes qui soit, n’ont pas de couverture sociale ou une couverture partielle, soit sont en rupture de parcours de soins du fait d’une grande précarité. Le but est que tout le monde ait accès à la santé. « Mon rôle, dit Julia, est de coordonner le parcours de soins du patient. Je suis présente lors de la consultation médicale et après j’assure le suivi du patient. J’accompagne aux différents RDV si nécessaire, j’explique tout le jargon médical et transmets les éléments médicaux que tout patient doit avoir en sa possession (résultats d’analyses de sang, compte rendu médical, résultats imagerie). Ils ont mes coordonnées et peuvent m’appeler, m’envoyer des messages et venir me voir à tout moment. » Elle fait le lien avec les autres services, avec les professionnels extérieurs, elle gère souvent l’interprétariat et essaie de faire en sorte que la personne soit en confiance et ait bien compris tout ce qui se passe dans son parcours médical. Elle est témoin de la détresse d’une personne qui ne va plus savoir où dormir.
Le tissage d’un lien social
« On essaie de trouver des astuces pour allumer les lumières de la personne pour se projeter. » (Isabelle.) Avoir pour mission la rencontre de personnes isolées dans l’intention de les re-lier à la communauté se heurte parfois à un obstacle inattendu pour un sujet naturellement social. Hervé, médecin de son état, apporte à notre connaissance le cas d’un patient qui vivait dans une cabane dans des conditions fort précaires, mais qui ne s’en plaignait pas : « il semblait vivre la vie de son choix, peut être comme expression d’une rupture avec la société, peut-être l’expression d’être rebelle, l’expression d’une indépendance, quelque peu fier de vivre comme ça. Il était résolument à part. Il était pour nous dans une grande précarité, mais finalement il n’en vivait pas si mal. » Il y a donc une population qui est dans le besoin et qui ne se manifeste pas, si certains peuvent, semble-t-il, se satisfaire de conditions précaires, d’autres ignorent qu’ils peuvent légitimement bénéficier d’aides sociales publiques. Nos échanges ont fait valoir que des personnes loin des villes, loin des services de santé ou des centres sociaux ne demandent rien, d’abord parce que leur isolement ne leur permet pas de pas faire connaître leurs demandes mais aussi parfois parce qu’elles ne savent pas qu’elles ont droit à des aides.
La demande de rendez-vous chez le médecin peut être un mode d’entrée pour exprimer un mal-être personnel ou social… constate Hervé : les problèmes de dénutrition, les problèmes financiers… La consultation à domicile permet d’être d’avantage en lien avec ce que vivent les patients. On prend la mesure du tabagisme, de l’alcoolisation. On voit comment ils interagissent entre eux… ce qu’est leur quotidien : « On voit ce cycle où on a de moins en moins de force pour réagir, de moins en moins d’énergie, de moins en moins envie de réagir, c’est un cercle vicieux qui conduit à baisser les bras. A force de ne pas bouger on perd des forces et à force de perdre des forces, on perd des moyens de récupérer des forces.… C’est une spirale dont on ne peut pas sortir. Si on veut les aider à s’en sortir, la réponse implicite c’est : foutez-moi la paix ! » Le médecin signale l’importance de la CMU, cette protection ne donne pas seulement un accès aux soins, elle inscrit des familles en voie de marginalisation dans une normalité sociale. Elle permet à ces personnes qui n’ont pas de gros moyens d’avoir accès aux soins : « Dans une société où l’on est une quantité négligeable si on a peu de moyen et bien là on trouve une considération qui vous maintient dans la société. Elle leur permet d’avoir l’attention, l’écoute de quelqu’un dont chacun a droit dans une société démocratique. »
Les personnes sont le plus souvent identifiées par un travailleur social : UTAS, Comité d’Accueil Creusois, CCAS, UDAF, Vitalis, L’Escale,…, parfois par le bouche-à-oreille. Il est constaté que la demande d’aide spontanée n’est pas facile : « Le plus dur c’est de pousser la porte, de faire le premier pas, de dépasser la peur d’être jugé. » L’association Entraide 23 reçoit des gens qui ont un domicile, mais la précarité s’y exprime de plus en plus : « Quand ils viennent au local, observe Stéphane, on les distingue tout de suite dans leur façon de se comporter, lorsqu’un enfant veut un jouet à 10 centimes et que le papa dit non, on peut pas ! On voit dans leur regard la gêne. On constate que les gens achètent de plus en plus de la seconde main, on leur offre des vêtements à très bas prix. Quand on voit toute la famille, ils viennent acheter l’essentiel de l’habillement, l’indispensable. Et ça s’arrête là parce que les meubles dont ils ont besoin, c’est non. Tout ce qui est confort ou gadget, ils ne s’arrêtent pas dessus. » Il constate que les personnes dans le besoin ont du mal à franchir le premier pas, à dire : « j’ai besoin d’aide ». C’est difficile de dire : « j’y arrive pas, j’arrive pas à faire manger ma famille. »
L’intervention sociale dans le domaine de la précarité est à rebours de celle pratiquée dans les services sociaux comme à la Carsat où la stratégie habituelle de l’intervention sociale tend à apporter une réponse à une demande exprimée, dans notre cas il faut aller vers la personne. En cela le temps de rencontre de la personne est essentiel, il faut pouvoir installer un climat de confiance. Elle se construit sur la base d’une absence de jugement, dans le respect de son rythme et de ses habitudes. On doit pouvoir éventuellement offrir des espaces hors cadre : « Les difficultés, dit Françoise, sont celles de l’entrée en relation avec tout être humain, il faut savoir écouter, comprendre ne pas juger, trouver sa place. » Ou encore : « Au Secours populaire l’accueil est inconditionnel explique Lucile. Bien accueillir les personnes doit être une priorité : respect de la dignité de la personne, favoriser l’estime de soi, relation d’égal à égal. Il n’y a pas celui qui donne et celui qui reçoit. » Au CHRS en raison du public très large et très varié, l’accroche est toujours différente. Il y a des personnes qui sont prêtes à accepter une rencontre et d’autres qui ne le sont pas du tout. Notre idée est de laisser l’opportunité à la personne d’accepter ou pas. On va provoquer cette rencontre par différent support, la maraude par exemple. Le réseau, l’échange avec les partenaires est indispensable. « Pour moi, il n’y a pas une chose particulière pour accrocher, chaque profil est différent. Cela demande une gymnastique quotidienne pour les professionnels. C’est de passer d’une problématique x avec une personne à une problématique y avec une autre. »
A titre d’exemple, Sandrine intervient à la demande du 115 auprès d’Henri. Henri accepte une première rencontre qui sera suivie de deux autres, un temps où il expose globalement sa situation. En raison de ses problèmes médicaux et psychiques elle lui suggère de consulter. Il s’y refuse, il craint les soins médicaux. Henri est orienté vers une maison-relais accueillant des personnes en voie de réinsertion. Il part au bout d’une semaine et revient sur le 115, demande à me voir mais ne vient pas aux rendez-vous. Il refuse ensuite d’être pris en charge par le 115 et dort dans la rue. Il perd ses papiers et son téléphone. Il fait la manche. Il rejette les propositions d’aide des éducateurs de la Maraude. L’infirmière prend l’initiative de lui offrir un café, là où il fait la manche. Il présente un effondrement psychique. Il pleure beaucoup, il s’attend à mourir dans la rue. Il refuse tout suivi médical. Elle lui fait part de son inquiétude devant l’altération de sa santé. Quelques jours plus tard, il rencontre la chef de service du 115 sur un parking de supermarché, il lui dit que sa fierté l’empêche à demander de l’aide à nouveau. A partir de ce moment-là, le travail des éducateurs permet à Henri de revenir sur l’abri de nuit et d’effectuer les démarches administratives pour percevoir à nouveau son RSA. Il accepte de reprendre les entretiens avec Sandrine et de revoir son médecin traitant.
Lors de la réunion Sandrine revient sur cet accompagnement : « Il y avait son désir à lui et le mien de le soigner mais nous n’étions pas sur la même longueur d’ondes. Je n’ai jamais forcé quoique ce soit. Je lui disais ce que je pensais, je lui disais mon positionnement. Je le laissais venir ou partir. Je lui permettais de ne pas venir. Le déclic qui a fait que la relation a changé est venu quand je suis allée vers lui sur le lieu où il faisait la manche pour lui offrir un café. Là, j’ai vu dans son regard une sorte de reconnaissance ; il m’a remercié plusieurs fois pour lui avoir offert un café à 1,50 euros. J’étais vraiment inquiète pour lui mais je n’ai pas forcé non plus mais j’ai dit mes inquiétudes, les risques d’hospitalisation. C’était en pleine canicule. Petit à petit, le travail du 115 et des maraudes lui a permis d’adhérer aux soins. Aujourd’hui, je le revois toujours mais je pense qu’il a moins besoin de moi. Il a accepté de rester au CHRS. Il y a des contraintes : des horaires à respecter, le problème de la consommation d’alcool. C’est énorme pour lui. Quand on détricote un peu leur vie et ce qu’il peut ressentir, cela peut être énorme. »
La qualité de l’écoute n’est pas l’apanage des soignants. A France Travail les personnes reçues sont étonnées d’être écoutées parce que souvent elles sont considérées comme des invisibles : « Un invisible passe et certains dans différents départements. Ils ont un cheminement, une errance et ils n’ont pas eu cette écoute. » Christophe insiste sur la notion d’alliance entre le professionnel et l’usager. Il est indispensable que la personne se sente entendue et considérée et trouve la bonne temporalité, attende que la personne soit prête : « Les personnes ressentent le besoin d’être simplement entendues. Dans l’accompagnement que l’on peut faire, nous sommes beaucoup sur l’écoute, l’entente, l’alliance. Vous ne ferez pas faire quelque chose à une personne qu’elle ne veut pas faire ou qu’elle ne peut pas faire, ou qu’elle ne comprend pas. Il faut cheminer avec la personne. »
Les bénévoles et les professionnels soulignent à quel point ce temps d’accueil et d’écoute de la personne est déterminant pour la suite. Les accompagnants pourront proposer des projets personnalisés, mais cela suppose que la personne soit partie prenante, sinon ça ne marche pas.
Il faut prendre en compte le fait que la personne soit prête à accepter ce qu’on lui propose : « On ne pense pas pour l’autre on pense avec l’autre » dit Léo. Les personnes disent les thématiques sur lesquelles elles veulent travailler après elles s’investiront ou… non. « C’est à nous d’orienter, mais c’est la personne qui fait son choix, c’est à cette condition qu’elle peut reprendre confiance en elle. »
Vivre en marge
La vie à la rue induit des comportements, des fonctionnements et des habitudes qui creusent l’écart avec la population sédentaire, logée, nourrie, entretenue, aux rythmes de vie bien établies. La réunion a mis en relief deux facteurs propices au rejet de la personne précaire : les odeurs et les chiens : « L’odeur, l’hygiène, l’appréhension de la relation quand elle est accompagnée d’un chien et souvent un très gros chien. » Ces particularités qui peuvent être pour certains un obstacle à la relation. Isabelle le formule ainsi : « C’est parfois difficile de discuter de toutes ses problématiques sans que les personnes se ferment : discuter de la différence est difficile. » Elle observe aussi la différence de tolérance selon les personnes employées au local : « Nous avons une employée pour le ménage dans l’association et parfois elle est choquée dans ses constatations du logement. Nous n’avons pas non plus le même regard. Il m’est arrivé de faire l’état des lieux du logement et de trouver que la personne accueillie avait fait un maximum d’effort. Et la personne à côté de moi avait trouvé que c’était choquant de voir l’état de ce logement. Nous n’avons pas tous le même regard, pas la même tolérance. »
Sandrine dit son admiration du médecin qui a reçu Henri : « : L’accueil du médecin traitant a été extraordinaire : 45 minutes de consultation, il l’a ausculté de la tête aux pieds. Il n’a pas manifesté de dégoût car ce patient vivant dans la rue ne sentait pas très bon, n’était pas très propre. » Alain M. souligne l’importance de l’acceptation de cette odeur : « Ce médecin a été certainement très important pour cet homme car son odeur c’est son odeur. Son odeur c’est lui aussi. Ce n’est pas une odeur que l’on écarte pour que le corps soit socialement acceptable. D’autant plus que les personnes qui vivent dans la rue ont des difficultés à accepter les soins. On peut se demander aussi si son odeur n’est pas quelque chose qui leur appartient. C’est une odeur qui leur appartient et que l’on ne sent pas, ce sont les autres qui la sentent. Il y quelque chose-là qui nous aide à réfléchir. La rencontre peut être autour de l’odeur. »
A LAUSEC « toutes ses questions sont là en ce moment. La majorité est favorable à ne plus prendre des personnes avec des chiens et une autre partie des bénévoles est favorable à la présence des chiens. C’est comme l’odeur, le chien de la personne ne peut pas être dissocié de la personne. C’est aussi une particularité du public que l’on peut accueillir. L’approche de la personne se fait par tout ça ; ses casseroles, le chien, les addictions… Ce n’est pas simple de rentrer en relation avec quelqu’un qui n’a pas des codes attendus, plus la précarité, plus au jour le jour. »
La place de l’animal est particulière : « c’est souvent leur seul ami. Nous avons accueilli une personne durant six mois ; tout tournait autour de la maladie de son chien. Son chien est malade donc il lui faut un logement. La première fois que j’ai entendu qu’il lui fallait un logement pour pouvoir se poser avec son chien car il est malade. J’aime les animaux, mais je n’ai pas les mêmes priorités. Il voulait un logement pour que son chien puisse mourir tranquille. Il y a deux réactions possibles : être choqué de mettre à disposition un logement pour un chien mais c’est tellement important pour la personne que l’on ne peut pas faire autrement que de l’écouter et de le regarder. De quel droit, je décide que ce n’est pas justifié ? » Isabelle de préciser : « quand j’accueille quelqu’un, je demande toujours le nom du chien et je note le nom du chien avec le nom de la personne. J’ai peur des chiens ce qui ne facilite pas. En général la personne apprécie la considération apportée à leur compagnon de route. » « Si je me présente avec un chien que j’adore et que je dis qu’il est le plus beau chien même s’il est moche ; et si quelqu’un me demande comment il s’appelle ; je vais me dire « toi aussi tu aimes ce que j’aime, tu fais partie de mon monde » ». La question sur la présence du chien est une question importante car cela peut poser des problèmes mais on peut comprendre que la présence d’un chien soit rassurante pour une personne qui est à la rue.
Au-delà de la présence rassurante, c’est aussi la question du lien et de leur humanité qui s’éprouve. En effet « dans ce sentiment d’abandon perpétuel qu’ils peuvent vivre la seule compagnie qui les suit c’est leur animal. » « C’est aussi, dit Alain, pour la personne un être vivant auquel il donne. Cela veut dire aussi qu’elle est capable de donner. » Isabelle de renchérir : « oui c’est ça. Quand une personne a un chien, on se dit qu’elle est en responsabilité car en général, les chiens sont assez bien soignés. Il y a une affection forte pour leur animal donc naïvement je me dis qu’il y a moyen d’échanger, de converser, de trouver des choses positives. » « Je vois des personnes à Bordeaux, commente Alain, qui sont souvent en groupe. Le chien est un lien entre eux. Cela leur permet de discuter autour de cet animal. Il y a quelque chose d’une vie sociale autour de cet animal, avec cet animal. C’est souvent un soin pour eux. Vous leur proposez une structure qui leur demande de se séparer de l’animal et qui leur fait violence. Est-ce qu’on peut imaginer un dialogue avec eux pour la représentation de cette vie avec un chien ? Est-ce que le chien est éducable pour eux ou représente-il quelque chose de sauvage pour eux ? »
Isabelle fait part de son expérience : « cela dépend des gens. Ils n’ont pas tous la même réaction. Nous avons eu deux personnes avec des chiens : un monsieur avec un très gros chien, il attachait son chien devant le logement le temps d’accueil et le temps de remplir ses papiers, alors qu’avec un autre le chien est là qui aboie, « c’est terrifiant », et il n’a rien mis en place alors que je lui disais que j’avais peur des chiens. Le chien peut être un lien mais peut aussi être un obstacle à la relation. C’est dure de faire entendre aux personnes les conséquences du comportement animal (pour les déjections devant le logement) C’est délicat de s’agacer envers des personnes qui sont déjà démunies mais parfois ces personnes abusent. On peut être dans la précarité et ne pas manquer de respect et d’éducation. »
Nul ne conteste cette fonction « thérapeutique » du chien, elle n’en demeure pas moins un problème dans les structures d’accueil en raison de décisions administratives et associatives. Les réserves concernent le risque de détériorations du bâtiment, la propreté de l’animal, le lien avec les enfants, la dangerosité du chien. Ainsi l’accueil de l’animal est restreint : « c’est suivant les personnes et la taille de l’animal de compagnie, précise Rachid, nous faisons quelques écarts et nous avons accueillis sur nos appartements type ALT des personnes avec petits chien ou chat. Il y a trois dispositifs au niveau du SIAO : le foyer CHRS, la Pension de Famille et Appartement ALT. La Pension de Famille et le CHRS n’accueillent pas les animaux. Il y a une tolérance en fonction de nos observations (taille, éducation) et il y a refus catégorique d’attribution de logement. La plupart refusent de se séparer de leur animal de compagnie (garde provisoire ou autre) et préfèrent ne pas intégrer la structure. » De fait il y a des impératifs incontournables : l’accès aux droits avec un animal même dans ces structures cela peut être impossible. S’il va aux urgences, il ne peut pas rentrer avec son animal.
Le SIAO est une des solutions parmi d’autres : « Nous proposons aux personnes de faire garder le chien ou autre. Nous conseillons aux personnes de faire une demande de logement social ce qui peut leur permettre d’accéder à un logement sans contrainte animale. Ce n’est pas un rejet, dit Rachid, nous leur exposons les solutions autres que celles de notre service. Je reviens sur l’histoire du gros chien évoqué précédemment. Ce chien qui est censé mourir depuis un certain temps et qui ne meurt pas, tant mieux pour le chien et pour le maître, mais faut prendre en compte les nuisances. Ce chien sympathique mais malade qui aboie dès qu’une personne s’approche, pas par méchanceté et c’est sa façon de dire bonjours selon le maître ! Ce chien fait ses besoins un peu partout, principalement devant le logement. Quand nous sommes interpellés par nos partenaires, le maître ne comprend pas car il estime que son chien n’est pas responsable. Cela peut être compliqué. »
L’accompagnement
La marginalité autorise des habitudes qui font obstacle au retour à une norme, Claire l’exprime en ces termes : « Effectivement, il y a des choses que l’on accepte avec ce public et que l’on n’accepterait pas avec d’autres personnes. Il y a en effet certains codes sociaux et certaines normes qui ne sont plus là où qui sont trop mises à mal, car la rupture avec la société est de longue date ou la présence de difficultés psychiques complexes. C’est très présent cette question des codes sociaux et de la norme. Dans quel ordre la société attend que les choses soient faites : démarches administratives, prendre un rendez-vous, faire une demande d’hébergement… Cela a un impact sur la question de la rencontre, sur la question du lien. Cela veut dire que les professionnels et les bénévoles doivent même au dernier moment s’adapter à ce que la personne va laisser comme ouverture à la relation. »
Cette remarque oriente les échanges sur les conditions structurantes de l’accueil de la personne. Il est en effet essentiel d’arrêter une prise en charge dans un établissement lorsque l’usager atteint un point de rupture. Le nombre des acteurs représentant des corps de métiers différents permet à la personne de toujours trouver un point de chute, un centre de jour, un hôpital ou un autre lieu, garant que le lien soit maintenu à un endroit. Le cadre structurant est tenu par le fait de savoir où sont les limites, de savoir que la prise en charge peut s’arrêter. Il est constaté que des personnes font des allers-retours dans les structures : « Nous recevons des personnes qui ont été orientées et qui reviennent dans notre service après une exclusion pour non-respect du règlement ou autres. Ces personnes débarquent à nouveau. Les personnes sont gênées, mais le lien est là. Pour moi, dit Rachid, ce suivi collectif permet à la personne le jour où elle est prête de s’insérer. » Alain apporte ce commentaire : « il y a une autre vertu à ce que vous dîtes. La personne peut mettre en acte un jeu de présence/absence. Cela lui permet de savoir qu’elle s’absente d’un lieu, que sa place est vide pour un temps. Dans ce jeu de présence/absence, il y a quelque chose qui est structurant. » C’est important qu’il y ait plusieurs structures et que la personne réalise qu’elle manque en ce lieu. Alain poursuit : « Il me semble que dans ce jeu de va et vient c’est important pour ses personnes de savoir que dans les lieux fréquentés il y a une loi qu’elles l’acceptent ou pas. Il y a des personnes comme vous qui se soumettent à cette loi donc elle n’est pas mortifère. Eux ne peuvent pas ou ne veulent pas mais cela existe. C’est structurant. »
Léo rejoint cette analyse : « La recherche du cadre et de la limite est sécurisante. Parfois les personnes n’arrivent pas à se soumettre à ces règles de vie en collectivité. Nous sommes quand même assez tolérants sur nos structures, nous individualisons aussi nos prises en charges. Il y a un cadre général et il y a l’adaptation du cadre en fonction des problématiques rencontrées. Nous savons aussi que derrière des structures comme nous (CHRS et 115) il n’y a plus rien. Nous sommes les derniers maillons. Quand une décision de rupture est prononcée, nous savons que cela va être très compliqué pour la personne. Nous savons que nous allons la remettre encore plus en difficulté. Cette limite du cadre sert à la personne au moment T et sert aux autres qui l’entourent qui constatent qu’il y a des limites. » Chacun reconnaît qu’en absence de cadre, le service s’expose à des dérives qui peuvent aggraver la situation.
La question est alors posée de la façon dont le cadre est fixé. Le CHRS a des conseils de vie sociale, ce sont des lieux d’expressions ouverts aux personnes accueillies pour débattre du règlement de fonctionnement. Cela amène à la réécriture d’un règlement de fonctionnement pour ajuster certaines règles en fonction de leurs volontés et la volonté des professionnels (soumis ensuite au conseil d’administration). Il y a des règles horaires, il leur est demandé de rentrer à 22h30, ce qui peut poser question dès lors que ce sont des adultes. Si l’on se réfère aux textes, la structure ne devrait pas imposer d’horaires. Les personnes devraient être libres et libres d’accès. Elles sont accueillies dans un lieu privatif, leur chambre, elles devraient donc pouvoir entrer et sortir comme ils le veulent. Léo s’en explique : « Nous travaillons autour de la réinsertion. La réinsertion commence par un rythme : se lever le matin pour réaliser certaines démarches, manger en collectivité le midi… Nous essayons de récréer une vie collective. Nous accueillons beaucoup de personnes avec des addictions. Les consommations sont souvent le soir. Ils vivent dans un bâtiment collectif où il y a une quinzaine de personnes, des familles avec des enfants. Cette mixité impose des règles. » « Si à un moment le désir est de rentrer « dans la vie sociale », insiste Christophe, il faut accepter à un moment donné certaines règles, certains codes. Il y a des choses que l’on ne peut pas se permettre de faire. C’est aussi entendre d’où part la personne car le petit pas effectué peut-être une grande victoire. » L’application du règlement n’est cependant pas draconienne, elle est respectueuse de la personne et du contexte, Claire en donne l’esprit : « Parfois la personne part de tellement loin par rapport au code que l’on finit par accepter des choses qui d’un regard extérieur serait totalement inacceptable. Pour autant, nous n’allons pas porter plainte, nous évitons de mettre la personne à la rue. Il y a une prise en compte du contexte. Nous mesurons le caractère de dangerosité pour la personne et son entourage. Nos institutions sont le microcosme où nous accompagnons la norme vers la société et parfois la norme n’est pas là ! Nous choisissons pour chaque situation de l’accepter ou non suivant le degré et la sécurité. »
Léo expose le cas d’une personne que bien des participants à la réunion ont accompagnée : « Cette personne était alcoolo-dépendante, très vulnérable avec 20 ans d’errance. Quand elle est arrivée au CHRS, elle était dépendante. Il n’y a pas le droit de consommer dans le bâtiment. Le premier travail au fur et à mesure est de lui demander de laisser ses bouteilles dehors. Elle les a d’abord laissées aux collègues. Nous sommes une structure où ce n’est en principe pas possible ! Les collègues conservaient les bouteilles pour pouvoir constater la quantité d’alcool consommée sur une journée. Puis on lui a demandé de laisser ses bouteilles dehors car c’est interdit à l’intérieur. Elle a caché ses bouteilles dans le buisson juste à côté du bâtiment. Cela a duré plus d’un an et demi. Nous avons travaillé en lien avec la MDPH et avec les services spécialisés. Aujourd’hui, cette personne est dans un foyer d’hébergement où il y a très peu d’alcoolisation. Elle a réussi à se réinsérer petit à petit. Si on ne casse pas les codes, si on ne casse pas les règles, si on ne le fait pas petit à petit, cela ne peut pas marcher. »
L’exemple cité permet de mesurer le chemin parcouru, car comme le précise Christophe si l’accompagnement de la MDPH par rapport à certaines personnes est essentiel sur le plan de la santé encore faut-il qu’il y ait une demande : « C’est toute la difficulté ! C’est toujours la volonté de la personne qui est prise en compte. Le texte définit ce que veut la personne et non ce que les équipes veulent pour elle. » Le CHRS a en effet recours à la MDPH pour avoir des mises sous protection ou pour avoir des accompagnements adaptés, mais cette instance se positionne beaucoup sur la volonté de la personne et sur son souhait et les grands précaires ne vont pas aller dans ce type de structure.
Un engagement social spécifique
Lors de la réalisation de cet atelier nous avons partagé l’engagement de bénévoles et de professionnels confrontés à l’âpreté de la vie en marge de la vie sociale commune. Il est légitime de leur donner la parole. La situation d’Henri nous fait témoin d’une bienveillance partagée. Celle d’abord des travailleurs sociaux qui permet son intégration dans la structure, grâce à laquelle son état général s’améliore rapidement. Il se sent en sécurité. Le sommeil revient. Celle ensuite du médecin qui fait l’admiration de Sandrine : « L’accueil du médecin traitant a été extraordinaire. Il s’est adapté. Il était très ennuyé car il voulait le faire hospitaliser mais il savait que ce patient refuserait. Il a essayé de trouver des solutions acceptables pour lui. » Au moment où Sandrine lui demande de préparer son argent, car il a récupéré son RSA, pour payer le médecin, celui-ci n’a pas demandé à être payé : « Quand je suis sortie de la consultation, j’étais estomaquée ! »
« Les professionnels qui sont dans ces structures sont là par vocation, dit Léo. C’est un choix de venir travailler dans une structure comme le CHRS où les conventions sont les moins avantageuses du secteur social. Nous travaillons 365 jours par an, du samedi au dimanche. Ce sont des personnes très humanistes, très ouvertes à l’autre qui ont le souhait que cette vie collective fonctionne. Pour moi, cela passe par l’intégration des personnes : intégrer les personnes dans le projet de vie, dans leur projet de vie en collectivité. Comment on va se faire découvrir à l’autre ? »
L’implication personnelle, les projections intimes, le ressenti que chacun peut éprouver à la rencontre de cette détresse n’en sont pas moins dangereux. Il est impératif de conserver une distance subjective pour se protéger et protéger la personne. Il faut aussi évoquer le risque de penser à la place de l’autre, de se substituer à lui. C’est un engagement qui exige d’avoir des échanges constants avec les collègues avec les autres professionnels, de croiser les regards avec les autres services. Léo : « On fait ce qu’on peut et on sait qu’on peut se tromper mais c’est comme ça qu’on s’améliore. C’est un engagement qui nous contraint à ne pas nous enfermer dans des habitudes, qui nous oblige constamment à nous adapter à de nouvelles situations. » Ce travail d’accompagnement n’est pas sans difficultés. Ainsi en témoigne Isabelle : « Que l’on soit dans la précarité ou pas, la précarité est un élément mais il y a aussi toute la sensibilité et le parcours des gens individuellement même s’ils travaillent dans le milieu d’accompagnement social ou médico-social. Ils ont des craintes. Ce n’est pas parce que l’on est médecin qu’il n’est pas difficile d’accueillir les odeurs. Nous sommes tous des êtres humains. Et pour le recueil de témoignages j’imagine qu’il n’est pas facile de parler de son expérience de précarité. Tout aussi difficile pour les professionnels de parler et d’admettre leurs difficultés et de chercher avec les autres comment résoudre ses difficultés. Nous ne sommes pas des robots. Je suis ravie de cette rencontre car nous nous sentons un peu isolés dans notre coin. »
Depuis le PASS, Julia exprime ainsi les difficultés spécifiques à l’accompagnement de la personne précaire : la barrière de la langue, la détresse physique et psychologique, les problèmes de communication avec les différents professionnels, entre établissements de santé par exemple, qui ralentissent la prise en charge ou font doublon car il n’y a pas de dossier PASS commun sur toute la France, Il y a peu de temps médical mais une demande en constante augmentation, pas encore d’aller-vers donc tout un pan de la population qui aurait besoin d’accéder aux soins se retrouvent seuls, sans ressource : isolement social, géographique, difficultés à faire des démarches administratives, c’est encore plus compliqué quand on n’a pas de médecin traitant.
Notre rencontre de ce champ social marginal, nous a fait constater l’importance du travail en partenariat avec un réseau le plus important possible car « nous ne pouvons rien faire seul avec ce type de public. » Et globalement, nous avons constaté que les échanges sont assez probants et qu’ils sont un des meilleurs atouts au soutien à cette population en errance.
Mise en perspective.
En guise de conclusion, nous proposons cette intervention de Léo lors de la réunion : « ce qui s’impose d’abord c’est aller vers, aller vers ces personnes, ces grands précaires. Nous sommes dans l’obligation d’aller vers eux si on veut un échange. La personne présentée dans le témoignage arrivée sur le CHRS, ce que nous avons pu repérer c’est tout d’abord un processus de sécurisation : avoir un toit, pouvoir manger, savoir où je serai tous les soirs et répondre aux besoins primaires. Pour développer ensuite d’autres choses : accéder aux soins, se mettre à jour au niveau administratif, avoir des ressources. Et ensuite penser un projet de réinsertion vers le logement. Dans cette phase de sécurisation, le lien est plus que nécessaire. On travaille sur le CHRS durant un mois et demi après l’arrivée de la personne sur la création de ce lien. Avant de définir des objectifs de travail de vraiment axer et orienter nos actions l’idée est vraiment de créer ce lien de confiance. Nous avons vu que cette personne est déjà passée sur des dispositifs où elle n’a pas réussi à rester. On demande à des personnes d’intégrer de correspondre, de s’adapter à un certain type de structure. On se veut d’être ouvert mais on a des règles, des limites, un cadre, puisque c’est un espace collectif. Ces personnes-là qui sont sorties de tout doivent quand même rentrer dans une case et en plus on leur donne une limite de temps. C’est à dire que la prise en charge sur le CHRS sur le papier est de 6 mois. Donc en six mois elle doit avoir repris sa situation en main, sa vie et être réintégrée. L’état nous permet de prolonger en cas de besoin ces accompagnements. Cela montre quand même que la société et notre fonctionnement administratif nous contraignent à beaucoup de choses avec des personnes qui sont hors de ces sphères. L’aller vers et la sécurisation pour la création de la relation me semblent indispensables. La notion de temps avec ses personnes ne peut pas rentrer en jeu. Quand on voit que la règle du 115 est de tourner tous les trois jours. Est-ce que ce n’est pas mettre plus en difficultés ses personnes là ? Est-ce que le manque de place dans nos structures d’accueil n’est pas problématique ? »
* * *
Moment réflexif
A l’issue de la réunion Alain D. demande aux participants de faire un retour critique sur cette d’initiative ? : « Comment l’avez-vous vécu ? Quel regard vous portez sur le travail que nous vous invitons à faire, »
Isabelle C: « C’est une super expérience. Cela nous permet de nous rencontrer car cela arrive très peu. Le lien qui peut se faire sur ce genre de projet, ce lien entre les gens car nous ne sommes pas amenés à rencontrer les différents professionnels et pourtant nous pouvons être amenés à travailler auprès des mêmes personnes. Je ne connaissais pas les rôles de chacun notamment à France Travail et je fais le lien avec un jeune en ALT en ce moment qui souhaite s’investir sur le marché du travail. Je devrais peut-être l’orienter vers vous (à Christophe B). J’ai découvert des professionnels sur le secteur qui m’intéresse donc. »
Léo D : « Moi je voulais vous remercier de nous avoir fait prendre le temps de se poser et de réfléchir. Nous sommes souvent dans l’urgence de notre travail et de notre vie personnelle. Prendre un peu de hauteur et de recul et pouvoir se rencontrer. A part les temps de formation qui nous permettent de sortir des carcans professionnels, nous avons peu de temps de réflexion nécessaire pourtant pour ouvrir notre esprit. »
Rachid L : « Je rejoins Léo et suis heureux de cette rencontre. Je trouve que deux heures pour débattre et échanger c’est court. J’attends la suite avec impatience même si c’est laborieux et fastidieux à mettre en œuvre, j’apprécie. Nous avons besoin de réfléchir car il y a des choses à dire et à faire. »
Sandrine L : « En tant que membre de Pluriact, je n’ai pas l’habitude d’être de ce côté ! Le sujet m’intéresse. Etant plongée professionnellement dedans, la réflexion est nécessaire. J’ai apprécié ces échanges et de rencontrer les personnes, mettre un visage sur un nom. »
Julia G : « J’ai apprécié car cela sort de mon quotidien dans le travail. Je n’accueille pas tout à faire la même population (plus demandeurs d’asile) mais le projet de notre service est de toucher les personnes que vous citez (rupture de parcours, non accès aux soins). Ces personnes isolées ne peuvent pas se rendre dans mon service (trop loin, pas connu). Le groupe a donné des témoignages, des expériences. Je fais connaissance des intervenants professionnels ou non professionnels qui interviennent auprès des personnes en situation de précarité. Pour moi, c’est hyper intéressant car pour l’instant, je suis très seule dans mon service et dans la prise en charge des patients. Je suis la seule infirmière et le médecin intervient une demi-journée par semaine. Je communique beaucoup avec les intervenants extérieurs mais sur un type de précarité. Aujourd’hui, l’intérêt était de pouvoir vous écouter parce que cela rejoint beaucoup ce que j’ai appris au DU Santé Précarité à Bordeaux. Je ne connaissais pas du tout votre association (LAUSEC). Même France Travail, c’est intéressant car même si j’accueille les demandeurs d’asile dès leur arrivée et que le travail n’est pas une priorité je pense qu’avec la loi immigration il va y avoir du changement. Je suis souvent la porte d’entrée des informations des demandeurs d’asiles. Connaître les dispositifs et les professionnels est un véritable atout. Je suis très intéressée s’il y a d’autres initiatives de ce genre. Merci beaucoup de m’avoir invitée. »
Hervé G : « Je découvre beaucoup de choses. Je me rends compte des multiples problèmes de la personne précaire qui impliquent de multiples solutions parfois contradictoires. Etant à la retraite je me sens désengagé, mais le recul peut donner un avantage. Au-delà de la vie professionnelle, nous pouvons rencontrer des situations compliquées pour les personnes. D’avoir participé à ce groupe, je sais qu’il existe des services. »
Christophe B : « La précarité au quotidien, dans mon domaine, c’est plutôt une précarité avec des personnes qui sont dans une démarche d’inscription à France Travail, avec une volonté plus ou moins directe de reprendre un emploi. Cela va évoluer car France Travail a été créé pour que toute personne soit identifiée. Même les grands précaires devront être identifiés à France Travail pour accéder aux droits sociaux (AAH, RSA etc.). Identifié ne signifie pas inscrit. Cela ne laissera pas des personnes de côté. L’intérêt de ces échanges est de pouvoir discuter de la précarité et connaître les actions des autres professionnels. Il y a plein d’actions qui se font dans le département et que l’on ne connaît pas. Cette rencontre aujourd’hui permet de rencontrer des pratiques, des professionnels. Cela permet les relais, les parcours. Tout seul, on ne fera rien. L’accès à la santé, c’est très compliqué. Merci. »
Le 15 octobre 2024