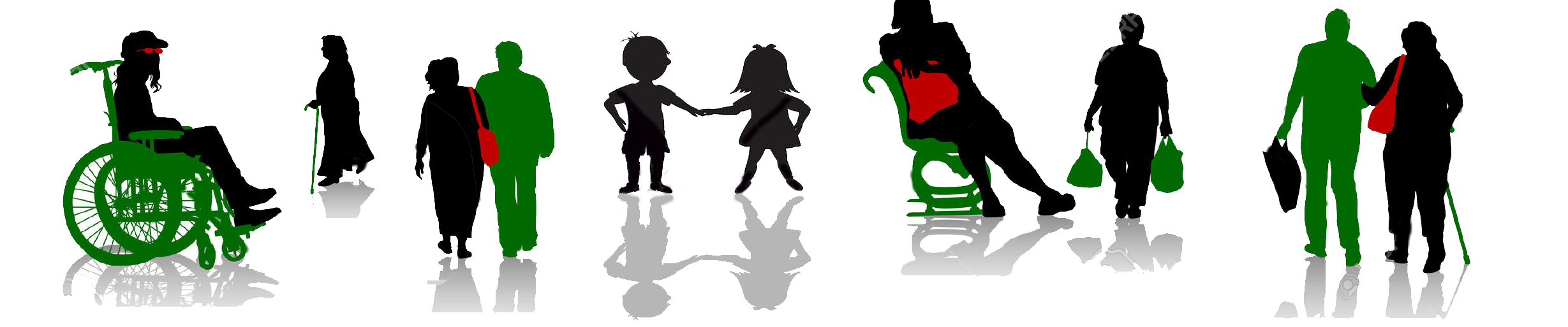Avec la participation d’Aline, Charles et Christian, anciens alcooliques, de Martine, mère de Jean, alcoolique, encore dépendant, de Geneviève CHAILLAUD, infirmière psy en retraite (SHALE de La Rochelle), de Brigitte DUDRUT, conseillère en économie familiale et sociale, diplômée d’état d’ingénierie sociale, travailleuse sociale à la MSA du Limousin, de Jean Claude ETILE, médecin généraliste, de Magali GUILLARD, psychologue clinicienne (Hôpital de jour du CAPPA et au CSAPA le Triangle, Nantes), d’Alain MOLAS (animateur), médecin, pédopsychiatre, membre du groupe de recherche, de Sandrine LARDILLER, infirmière psychiatrique, membre du groupe de recherche et d’Amandine ROUGEOL, infirmière (CH d’Aubusson), membre du groupe de recherche, (secrétaires de séance). Synthèse composée par Alain DEPAULIS à partir des témoignages individuels et collectifs.
Nous avons recueilli le témoignage individuel de personnes ayant souffert de l’alcoolisme et de professionnels concernés par cette maladie. Elles ont accepté une rencontre afin d’échanger leur expérience. Ce sont ces paroles d’usagers et de professionnels que nous livrons.
La thématique de la dépendance met en lumière des problèmes spécifiques à la personne alcoolique. Entraîné dans un système dans lequel il sombre, il est d’abord dans un déni de sa dépendance, il lui faut un élément déclencheur pour prendre conscience de sa dégradation. Durant son naufrage, il dissimule, il ment, il est imperméable aux discours qui lui sont tenus, il ne se prête pas spontanément aux soins. Cette problématique se caractérise par un jeu de cache-cache avec les proches et les soignants. Elle nous offre une analyse originale du rapport patient-professionnel révélant de façon éloquente l’impératif d’être acteur de son rétablissement, de sa guérison. Ce n’est que parce qu’à un moment il se prend en charge, qu’il se responsabilise que l’alcoolique parvient à se libérer de sa dépendance.
Comment on tombe dans le système !
Nos témoins ont été des consommateurs d’alcool comme tout le monde[1]. L’entrée dans la dépendance est insidieuse, chacun d’eux dit avoir été habitué à prendre quelques verres, avant de vivre un jour des insatisfactions profondes dans sa vie : faire un métier déplaisant, avoir des problèmes conjugaux ou familiaux. Et insensiblement de se mettre à boire pour supporter et oublier : « Ça peut être lié à plein de choses, dit Aline, j’étais dyslexique et puis les problèmes de la vie. » La première remarque porte donc sur la vertu d’oubli de l’alcool : « C’était un moyen d’oublier les horreurs de ma vie ». « Je peux pas dire que c’était un médicament mais l’alcool me permettait d’oublier. » Ainsi la personne se laisse-t-elle tenter par les apéros à répétition et rentre dans le cercle.
Au dire de nos témoins, il y aurait un fait de la vie qui exacerbe l’habitude innocente de boire un verre, un événement qui embarque dans l’engrenage. La perte d’une figure tutélaire, le décès de son père a provoqué la descente aux enfers de Christian : « J’ai fermé les portes à tout le monde et je me suis vraiment mis à boire. J’emmenais même de l’alcool sur mon lieu de travail. Ma famille ne savait pas comment me prendre, j’envoyais tout le monde promener. Avec mon père on était proche, quand il est mort, j’ai perdu un gros pilier. Je pouvais avoir confiance en lui, je me suis trouvé tout démuni. » Ainsi constate-t-il : « C’est quelque chose qu’on n’arrive pas à contrôler. A la fin je buvais du Ricard pur. A 2gr mon corps marchait normalement, mon corps était vraiment pris par l’alcool. »
Pour Aline le facteur déclenchant a été le viol d’une de ses filles : « Cette annonce a été pour moi une horreur, je n’ai pas pu en parler. Je m’en voulais de ne pas avoir vu ce qui arrivait à ma fille. Je ne comprenais pas ce qui lui arrivait, ce qu’elle me disait. J’étais seule, j’ai commencé à boire énormément, tous les soirs à partir de 18h, j’avais peur de la nuit. » A ce stade elle avait conscience de sa chute, il lui est arrivé quelquefois de prendre la bouteille et de la vider dans l’évier : « A peine je l’avais vidée, je partais en vrille, c’était horrible ! » Pour Charles la trahison de sa femme et l’abandon ont été déterminants : « Dès que j’ai su que ma femme allait en voir un autre, je suis tombé dans le système, je me levais avec l’alcool, ça a duré deux ans. Pour moi ça a d’abord été une facilité, après ça a été un cercle vicieux. C’est un moyen de se dire je vais oublier tous les tracas, je vais picoler. Dès 10h je ne prenais que du Ricard. » Charles ajoute un autre fait marquant, il s’est cassé le tibia au football : « J’étais dépendant de quelqu’un, je ne pouvais pas me déplacer, j’étais en fauteuil roulant. Elle m’a laissé dans cet état-là, elle est partie sans me prévenir. C’était un moyen de me dire tu vas oublier tous tes soucis. »
Par-delà la vertu de l’oubli, l’alcool a une fonction positive, il lève les inhibitions et donne de la force. Aline l’exprime ainsi : « Pour moi c’était pouvoir dire des choses que je ne pouvais pas dire, c’était avoir confiance en moi. J’étais une femme forte, je pouvais me permettre plein de choses, alors qu’en temps normal du fait que j’ai été une enfant introvertie je ne m’exprimais pas facilement et tout ça je ne l’ai pas exprimé. Avec l’alcool j’avais l’impression que j’étais bien que je pouvais m’exprimer, j’étais capable d’affronter les moments difficiles. Même si j’étais seule, l’alcool me permettait de dire ce que j’avais envie de faire au type qui avait violé ma fille, d’aller hurler aux gens combien cet individu était moche. Je trouvais ça tellement injuste. » Christian confirme : « Tout est possible quand on est alcoolique. »
Ensuite, lorsque le corps exprime les premiers désordres, « On se rend compte qu’on est dans cet engrenage, on ne sait plus comment en sortir. On se dit aujourd’hui c’est le dernier verre et le lendemain, on n’est pas bien et on commence par trembler, ensuite on a des sueurs froides, on prend un verre pour faire face et ça empire… On commence à s’en rendre compte par ces tremblements incessants, à être mal à l’aise dans la foule, à être angoissé, on se rend compte qu’on est plus ce qu’on était avant. Avant ça m’arrivait de boire des apéros, de prendre des cuites, mais là j’étais complètement dedans : je vivais Ricard, je dormais Ricard. »
La vie dans l’alcool
Le premier trait qui se dégage de l’univers de l’alcoolique est le mensonge, un mensonge épuisant dont nul n’est pourtant dupe : « Pour moi l’alcool c’est le mensonge en permanence, c’est fatigant d’être alcoolique c’est épuisant parce qu’on ment tout le temps à tout le monde. On veut cacher ses faiblesses donc on est tout le temps dans le mensonge. En se disant : « Comment je vais le cacher ? On sait que tout le monde le voit mais on veut se persuader qu’on peut le cacher. » L’alcool poursuit Aline : « Je l’ai vécu comme un mensonge perpétuel, comme une lutte, un combat. C’est fatigant, on est fatigué. » L’alcoolique dissimule, il est dans des calculs permanents : « Le temps qu’on va mettre pour chercher la bouteille, le temps qu’on va mettre pour la boire, et puis il en faut une autre derrière… c’est épuisant. » Sans compter les problèmes d’argent parce que l’alcool, Ricard ou whisky, ça coûte cher.
La dépendance a pour conséquence une désorganisation du comportement : « Moi j’avais besoin de boire quand j’étais au téléphone, dit Aline, et j’avais besoin d’appeler parce que ça me permettait de parler, j’appelais les gens, je buvais en même temps, je suppose que la personne de l’autre côté entendait tout ça. Elle devait continuer à faire semblant de m’écouter. Dans ces cas-là, j’étais parti dans des délires, ça pouvait durer des heures et des heures. » La prise d’alcool s’accompagne de mises en danger : « Je savais que je m’en allais vers ma propre mort, parce que dans ces cas là j’étais capable de prendre la voiture et de faire n’importe quoi. J’étais capable de partir. Je me sentais bien, je croyais être bien et je me disais : « aujourd’hui ça y est, je m’en vais ». Ça m’a posé des problèmes, j’ai été plusieurs fois dans le fossé avec ma voiture. » Le haut niveau d’alcoolisation entraine une dégradation mentale et physique : « Moi c’était catastrophique, dit Christian, j’étais comme un nourrisson toutes les trois heures la nuit je me levais et je buvais, si je me couchais à 20h, trois heures après je me levais, si je me couchais à 21h trois heure après je me levais. »
Nous constatons que la personne gagnée par cette dépendance destructrice conserve une conscience douloureuse de ce qu’elle vit, avec la persistance des motifs de l’écueil : « C’était quelque chose d’assez contradictoire, dit Aline, je voyais où tout cela m’emmenait, ça allait me détruire et en même temps je continuais, je n’avais pas du tout envie de perdre la vie et pour ma fille, je voulais être une maman à la hauteur. Et maman à la hauteur quand j’avais bu je ne l’étais plus. Je n’avais pas les bons mots, je n’avais pas les bons gestes pour la rassurer. » L’alcool isole complétement : « Au début on parvient à accepter des invitations mais on sait que le verre d’alcool ne sera pas suffisant, on commence à boire avant d’y aller comme ça on est sûr d’avoir sa dose, mais on le cache aux gens, c’est encore le mensonge. » Charles vit le même cercle vicieux : « Je ne sortais plus. Je prenais mon Ricard dès 10h. L’après-midi je faisais ma sieste. Une fois relevé, je réattaquais. On est seul avec notre alcool ! » Il reconnait ne pas avoir été facile à vivre : « Je suis quelqu’un de très nerveux, je n’étais pas méchant mais je répondais sèchement. J’étais angoissé, oppressé, sec dans mes réponses. Je ne voulais entendre les conseils de personne. Dans l’alcool, c’est nous qui avons raison on est les plus forts ! »
La vie professionnelle s’en trouve évidemment affectée, dans le pire des cas l’alcoolique perd son emploi et se retrouve dans une situation financière précaire, Charles ne touchait même pas le RSA, il avait 500€ de Pôle Emploi par mois : « On s’enfonce beaucoup plus vite qu’on ne va se relever. Aux yeux de la société on n’est plus rien ! » Christian a bénéficié d’un environnement professionnel particulièrement conciliant : « Au travail j’emportais ma bouteille. Quand mon patron s’en est rendu compte il m’a sermonné, il m’a envoyé des lettres recommandées. Il m’a demandé de me faire soigner. J’ai eu des patrons que je connaissais, ils ont tout fait pour que je m’en sorte, ils m’ont pas menacé de licenciement. Ils ont été très contents que j’aille en cure, quand je suis revenu je n’ai eu aucune réflexion. Ils m’ont soutenu. Même mes collègues de travail, mais j’en parlais librement. » Aline consommait de l’alcool le soir, le weekend et les jours de repos, elle a réussi à poursuivre son activité professionnelle au prix de faux prétextes pour les fois où elle n’a pas pu se rendre à son travail : « Il fallait arriver au travail en étant présentable. C’était des combats au quotidien. »
La famille, les proches, les copains
Les membres de la famille s’accordent à dire combien l’accompagnement du malade de l’alcool est également épuisant pour eux. Aline se souvient : « Au début ma fille me disait : « maman, j’ai l’impression que tu as trop bu ». Une de mes filles avait de la compassion, l’autre était plus virulente. Je ne peux pas dire que ça me faisait du bien parce que ça me renvoyait ma faiblesse, ce que je ne voulais pas être. Ça me dévalorisait plutôt que de m’aider. Cette période a été particulièrement douloureuse. » La vie familiale est bouleversée, les proches assistent démunis à cette détérioration : « Tout le monde était angoissé pour moi. Ma mère et mes sœurs s’entretenaient entre elles. Ma fille s’est en plus culpabilisée de mon état puisqu’elle était responsable de ne pas m’avoir parlé de ce qui lui arrivait : « C’était coupable, coupable, coupable… ». Et d’ajouter : « C’est terrible parce qu’on est insupportable en tant qu’alcoolique. L’alcoolique qui boit et qui va se coucher c’est déjà difficile, ça doit être terrible pour les accompagnants. » Christian était dans un tel état que sa femme et ses enfants étaient obligés de l’emmener au lit. Il était conscient de ce que ses proches supportaient : « Ma femme et mes enfants n’étaient pas heureux, je m’en rendais bien compte, mais quand on est dans cet engrenage, on ne sait pas comment faire pour en sortir. »
C’est par la bouche de la mère de Jean, alcoolique, que l’on saisit le mieux les affres vécues par les proches. Martine ne s’est pas rendu compte tout de suite que son fils devenait alcoolique. Son témoignage dit le long chemin qu’elle a dû parcourir pour réaliser la gravité de sa maladie : « Dans un premier temps, une inquiétude vague m’a envahie car il se coupait de la famille. Je n’ai pourtant pas vraiment pris conscience que l’alcoolisme s’installait. Par la suite j’ai désapprouvé son comportement car pour moi il était incompréhensible qu’il ne puisse pas, par un effort de volonté, maîtriser son besoin de boire. Ce fut une période de reproches, d’inquiétude et d’incompréhension. Je n’ai pas pris la mesure de la gravité de la situation. On ne peut pas croire que son enfant est devenu alcoolique ! Il se trompait lui-même en affirmant qu’il pourrait arrêter de boire quand il voudrait et je ne demandais qu’à croire ses affirmations tout en prodiguant observations et conseils. » Passé le temps des reproches, il est apparu à Martine que toute suggestion, tout conseil était également vain. L’absorption d’alcool lui était devenue indispensable pour se sentir bien et l’addiction s’est installée. Il a vite été rejeté par ses collègues. Son addiction fut telle qu’il n’a pas pu continuer à travailler Ainsi a-t-elle assisté impuissante à sa destruction progressive.
Jean a fait une douzaine de cure, Martine porte un regard sévère sur la brutalité des soins qu’il a reçus et l’absence d’accompagnement des proches, elle fait part de son vécu de mère : « Voir mon fils se détruire en étant laissé de côté par des thérapeutes qui, sans doute à juste titre, se méfient des mères, m’a apporté un énorme poids de culpabilité, de désarroi et de colère. Devant la répétition des insuccès « J’ai osé, dit–t-elle, téléphoner à son médecin. Il m’a répondu poliment : « Madame, votre fils est adulte, je verrai avec lui » ». Ainsi vit-elle la frustration d’être écartée. C’est cette absence d’écoute et son impuissance à lui porter secours qui ont conduit Martine à parler librement de l’alcoolisme de son fils à des personnes de son entourage : « Il a fallu un profond changement intérieur pour que je sorte du jugement en prenant conscience qu’il s’agit d’une maladie. » C’est à un vrai travail personnel qu’elle s’est livrée, c’est : « Un cheminement qui m’a permis d’améliorer mon estime de moi, de m’accepter, qui m’a permis de croire dans les potentialités de mon fils, de croire que chaque personne a une vie particulière, que toute vie, même très cabossée a une immense valeur et qu’on doit respecter sa particularité, même si l’on n’y comprend rien. » C’est à partir de ce moment que s’est effectué un authentique changement dans leur relation : « Le moment où j’ai commencé à sentir que j’aidais mon fils au lieu de lui en rajouter en lui donnant des conseils en permanence, c’est le jour où je me suis dit : « j’accepte de ne rien comprendre à son fonctionnement, je renonce à essayer de faire à sa place, parce que je fais mes propres stratégies qui ne correspondent pas à ce dont il a besoin » ». Dès lors son attitude a changé à l’égard de son fils, elle s’est faite d’écoute et d’encouragements, saluant chaque progrès dans son gain d’autonomie. La relation avec son fils s’est transformée, les échanges sont ouverts et respectueux, fondés sur la confiance : « Nous avons maintenant des contacts fréquents et sincères, le problème n’est pas résolu mais l’un et l’autre nous avons gagné en confiance réciproque et en espoir de guérison. La souffrance n’est plus la même. »
De ce long chemin, Martine a beaucoup appris. Elle a déployé une énergie considérable, tenté, en vain tous les remèdes possibles pour constater dit-elle : « qu’il faut vraiment que le désir de se soigner vienne de la personne elle-même. Pour ça il ne faut pas qu’il y ait des jugements de l’environnement proche sinon ça bloque la personne dans les stratégies de dissimulation. Les personnes autour, ce n’est même pas une question de bienveillance, mais reconnaître la valeur de la personne. Il faut instaurer une relation directe, hors du mensonge, supprimer l’espèce de verni qu’on met. En tant qu’accompagnant il ne faut pas jouer un rôle, être soi-même et si on a envie de dire qu’aujourd’hui tu as charrié, ne pas arranger les choses. Il faut arriver à avoir de vraies relations avec la personne, ni dans le jugement, ni dans la protection exagérée, être soi. »
Martine le dit avec force et tous nos témoins l’expriment : la sortie de la dépendance est favorisée par le soutien du proche environnement. Ainsi de Christian dont il faut dire qu’il a bénéficié d’un soutien exemplaire depuis sa mère jusqu’à ses collègues de travail en passant par sa femme, ses enfants, ses beaux-parents, ses neveux, sans oublier son médecin généraliste auquel il voue une profonde reconnaissance : « Ma mère était désespérée mais elle m’a toujours fait confiance. Je la voyais beaucoup. J’arrivais chez elle : « Allez viens on va boire un café ! » Qu’est-ce que j’ai pu en boire du café ! Trois quatre cafetières par jour. » Sa femme avait soin de lui proposer des sorties, des activités : « On pourrait aller là, on pourrait… il n’y avait pas de temps morts, il y avait toujours quelqu’un pour me soutenir. » Vivant seuls leur alcoolisme, Annick et Charles se sont davantage isolés mais ils abondent dans le même sens quant au soutien apporté par leurs proches. Ces trois anciens alcooliques ont bénéficié d’un entourage favorable, comme dit l’un d’eux : « Parce qu’il y a toujours un moment de faiblesse, si il y a pas la personne pour vous donner un coup de pouce, on replonge. »
Les fréquentations sont un critère de l’évolution du patient : « Tu vois plus tes potes que tu avais avant, dit Charles. On t’évite, on t’évite pour discuter mais pas pour boire un canon. Il y a des gens qui sont là que pour ça. Vous avez des potes tous les jours, des potes d’apéritif et après quand vous êtes malade que vous avez besoin d’aide, on crie au secours mais ces gens-là vous ne les voyez plus. » Christian fait le même constat, les visites se font rares : « Lorsque l’on commence à sombrer les amis viennent de moins en moins et quand on revient de cure on ne les voit plus du tout. » Il reste cependant les vrais amis. Contrairement aux copains de beuverie qu’il ne voyait plus, il en avait deux qui manifestaient leur gêne, ils ne savaient plus comment l’aborder. C’est lui qui a pris l’initiative de leur parler de son alcoolisme, dissipant ainsi leur embarras. Aline témoigne d’un vécu différent, selon elle, les femmes sont plus dans le camouflage, elles consomment moins à plusieurs, son alcoolisme était solitaire : « J’ai l’impression que les femmes boivent plus seules chez elles quand les enfants sont partis à l’école. » Jean-Claude a travaillé en planning familial, il fait le constat de différences générationnelles, aujourd’hui il y a moins de différences sexuées, la consommation d’alcool chez les jeunes filles est beaucoup plus importante qu’on imagine.
Jean-Claude livre son expérience de médecin dans la prise en charge des patients : « Etre médecin de famille à la campagne c’est être médecin de toute la famille ou d’une grande partie de cette dernière et d’avoir parfois l’impression de ne pas recueillir le soutien inconditionnel et impartial pour le malade de l’alcool. » Il est nuancé quant au comportement des proches : « Les familles quand elles sont solidaires et aimantes pour le patient c’est un vrai bonheur pour le travail de soignant, mais je n’ai jamais eu le sentiment que la guérison ou le changement dépendait de la volonté de l’entourage. Il m’a fallu souvent leur dire qu’à la fois leur inquiétude était justifiée mais qu’il leur faudrait pouvoir apporter leur énergie au moment où le patient serait prêt. J’ai souvent vu des patients et des familles qui n’étaient pas synchrones, des familles qui ne pouvaient pas, ne savaient pas attendre le moment où le patient se met en marche, c’est là une grande difficulté dans l’accompagnement des familles. A la réflexion il est fort probable qu’une prise en charge des familles soit indispensables pas nécessairement dans le cadre d’une institution, mais à formaliser par le médecin traitant qui est souvent le premier recours. »
Echapper à la mort promise
Engrenage ou cercle vicieux nos témoins expliquent comment ils ont glissé dans cet enfer et combien il leur a été difficile d’en sortir. Les obstacles sont nombreux qui maintiennent le patient dans sa dépendance. Certains y parviennent avec le concours de leur seul médecin, d’autres avec l’apport d’un suivi à domicile, d’autres enfin grâce à des cures. Comment cette descente en abîme peut-elle s’enrayer ? Quels sont les appuis que l’on peut identifier pour en sortir ? C’est au service des réponses à ces questions que nos participants se sont attachés.
Des tiers, parents ou enfants, médecins, travailleurs sociaux sont souvent à l’origine des premières alertes. Ainsi Brigitte, conseillère en économie sociale et familiale, répond à divers appels : « Ça peut être un maire confronté à la situation d’un exploitant avec de la mortalité de bêtes, l’inquiétude de l’environnement professionnel, familial, parfois à la demande des médecins parce qu’il y a des moments où on sent bien qu’il faut une hospitalisation. Des hospitalisations à la demande de tiers, on a fait ce qu’on avait à faire, il y a des situations on l’aurait retrouvé mort. » Certaines situations sont particulièrement violentes et dramatiques : « On va pointer ce qui ne va pas, ça peut parfois être extrêmement cru, récemment on est intervenu sur une dénonciation, il y avait un bâtiment plein de vaches mortes, le monsieur n’avait pas réussi à s’occuper de ses bêtes, les vaches étaient enlisées dans plus d’un mètre de fumier et elles sont mortes. Tout le monde était mal. On est confronté à quelqu’un qui n’y arrive plus qui n’arrive plus à mentir. Il est dans un état physique et psychique préoccupant il ne peut plus dissimuler les choses, quand c’est sur plein de plans comme ça, il ne faut pas oublier l’humain et ne pas handicaper la possibilité de soins futurs. »
Lorsque la demande émane d’un tiers le patient s’y plie le plus souvent passivement : « Ma première cure, dit Christian, j’y suis allé parce qu’on a dit d’y aller, six mois après je retombais. » Jean en a fait une douzaine. Dès qu’il sort, il va s’acheter une bouteille de whisky. A la question de sa mère : « Mais pourquoi tu fais ça ? Tu vois bien que c’est stupide, c’est contradictoire, tu pars en cure et tu bois. » Il répond : « C’est un défi ! » Combien de cures, de tentatives faut-il pour qu’une démarche fasse sens ? Les professionnels constatent que les tentatives avortées ne sont pas nécessairement négatives, un travail souterrain se fait. Brigitte rapporte cette situation : « Une fois, on a eu une grosse pression d’une famille pour faire hospitaliser un monsieur. Le monsieur ne le souhaitait pas. On en parlait de plus en plus, la parole des proches s’était libérée. Ils n’en pouvaient plus, ils étaient très inquiets. A plusieurs, on se relayait en veille, il y avait deux ou trois interventions par semaine, car on pensait qu’un matin on pouvait le retrouver mort. Il y avait une très grosse pression, son état se dégradait. Un jour, on y est allé avec le médecin traitant car on avait décidé de le faire hospitalisé. Il nous a ouvert. Il avait préparé son sac. Ça a été un tel soulagement. Ou alors il l’a fait pour nous faire plaisir ? C’était très étrange. »
Le premier pas est certainement celui qui consiste à ne plus se voiler la face comme le fait Jean lorsqu’il dit à sa mère qui ne demande qu’à y croire : « Je peux arrêter de boire quand je veux ! » Il y a donc ce moment où même s’il le cache encore à autrui, l’alcoolique réalise qu’il est devenu dépendant de l’alcool. Christian le dit clairement : « Quand on se rend compte qu’on a un problème d’alcool, quand on se rend compte qu’on ne peut plus faire machine arrière, si on n’a pas ce déclic nous-même, ce n’est pas la peine. » Après la première cure subie, il a assumé la seconde : « Là j’ai dit : c’est bon. » Aline détaille ce premier pas, le mensonge lui devenait insupportable, lui inspirant le dégoût d’elle-même, elle décide d’en parler à son médecin traitant : « J’ai pris rendez-vous, j’ai prétexté un mal à la gorge, et je me suis dit : « faut l’dire, faut l’dire, faut l’dire ! » D’un seul coup c’est sorti, j’ai dit : « je suis alcoolique ». J’ai le souvenir d’avoir pensé : « Pourquoi t’as dit ça ? » Mon médecin a appelé le psychiatre, et ça s’est enchaîné mais pour moi c’était le bon moment. De toute façon je savais que je m’en allais vers ma propre mort. »
Le bon moment ! La notion de temporalité n’a cessé de traverser les échanges, ce temps que le patient doit prendre pour franchir ce pas qui conditionne sa libération de la dépendance, ce temps singulier fait de l’évolution de son état, de sa prise de conscience, de son entourage, de ses rencontres… Ce temps qui fraye vers sa reprise en main : « Il faut arriver à se rendre compte qu’on est alcoolique, si on s’en rend pas compte, on ne peut pas se soigner. Si ça ne vient pas de la personne ça ne marche pas. » Dans les témoignages, ce bon moment s’est à chaque fois trouvé présentifié par un signe, tendu tel un miroir, qui vous renvoie votre réalité. Ce fut pour Christian cette parole sans doute cent fois entendue mais qui tout à coup prononcée par son médecin fit sens : « Si tu continues comme ça dans six mois t’es mort. » Aline se réveille un jour et se rend compte qu’elle a oublié de nourrir ses chiens : « Là je me suis dit : « tu perds complètement les pédales, t’es même pas capable de t’occuper correctement de tes chiens. Il faut vraiment réagir », le lendemain j’ai pris rendez-vous avec mon médecin. » Charles s’interroge : « On ne sait pas quand c’est le moment mais je me suis levé un matin en disant : « c’est plus possible ». » Et pourtant c’est bien l’image que lui renvoie son miroir qui le décide : « En me regardant dans la glace, je me suis vu boursoufflé. Des cernes jusque-là je ne peux pas continuer. C’est le fait de m’être vu. Je n’étais pas beau. » Ainsi le formule Alain l’animateur : « Dans tout ce que vous avez décrit, cette notion du temps est fondamentale, plusieurs personnes ont insisté sur le bon moment, le moment où quelque chose est possible, ça s’ouvre. Ça ne vient pas au hasard, c’est quelque chose qui est préparé, plus ou moins clairement. Il y a ce bon moment où vous prenez la responsabilité de vous-même. »
Le bon moment et… la bonne personne : car il n’est pas facile d’en parler : « Quand on a le déclic, on se demande comment en sortir, on a honte du regard des autres. Le regard des autres me faisait peur. » C’est de cette place où il se vit comme inférieur, majoré par le fait que la société lui renvoie qu’il n’est plus rien, que le malade de l’alcool doit arriver à reprendre la parole : « Mais si vous, vous êtes prêt, il faut tomber sur la bonne personne, la personne qui va vous écouter. Si on a ce bon contact, on va attendre la suite, que l’accueil de la structure soit prêt pour vous accueillir. » Ce moment de rencontre de l’oreille bienveillante est très délicat, il y a des associations qui l’ont bien compris rapporte Magali, psychologue : « J’entends beaucoup dire dans les consultations que le premier accueil est primordial : « On prend soin d’elle, on l’a pas brusquée, on lui explique les choses. »
Le médecin généraliste est plus que tout autre confronté à cette question de la temporalité. Dans l’addiction l’acte médical se joue des codes traditionnels, il demande d’accepter le temps du patient : « Je n’ai eu personnellement à lutter contre aucune addiction, confie Jean-Claude, donc pour moi, c’est un monde inconnu dont j’ai pu constater les effets négatifs et souvent mortels sans pouvoir en imaginer les effets : bénéfiques, joyeux, agréables, plaisants ? » Son ignorance et son incapacité à comprendre émotionnellement les effets de l’alcool ont animé sa curiosité. Avec attention, il est entré dans ces histoires singulières partageant ainsi le cheminement de son patient : « Il nous est arrivé de pouvoir cheminer ensemble, je dis « nous », parce qu’à aucun moment je n’ai eu le sentiment d’y être pour quelque chose, j’ai senti que nos échanges étaient un travail partagé qui permettait de bouger un peu, parfois juste de tenir, de ne pas laisser s’aggraver la situation, parfois de se dire qu’aujourd’hui ce n’était pas possible mais demain, après-demain. J’ai vécu des moments intenses de découragements, d’agacement, de colère, d’avoir l’impression de perdre mon temps, de ne pouvoir être d’aucune aide et de ne pas avoir les outils personnels et institutionnels. Il est possible qu’un groupe de pairs ou une supervision m’aient été bénéfiques. C’est ainsi que petit à petit j’ai commencé à apprendre, à comprendre comme un lecteur qui pénètre dans un autre univers et j’ai fini par suivre les cours d’un DU d’addictologie. »
.
« Il y a eu un temps, dit Jean-Claude, où je me sentais dans l’obligation de soigner, après je me suis rendu compte qu’il était plus simple d’attendre le moment où la personne était en capacité de changer. Quand la personne dit : « Je veux arrêter » ». Il explique que dans sa pratique il avait pour habitude de questionner une fois sur l’addiction : « Poser des questions sur les habitudes de vie c’est tendre le miroir et signifier qu’on est prêt à recevoir le moment venu les confidences du patient. » Il ne faut pas être dans la posture : « Je vais soigner quelque chose » mais se mettre dans la position de poser une question : « Tu réponds, tu ne réponds pas, mais si tu réponds dans dix ans… c’est ouvert ». Plusieurs années après il a eu la surprise de voir revenir la personne et lui dire : « Vous m’aviez dit… » Jean-Claude explique que dans sa pratique professionnelle il est important de questionner les patients sur leurs habitudes. Si on a l’idée de faire le programme à l’avance ça ne correspond pas au temps de la personne, au contraire il faut laisser faire le temps. Le fait de dire simplement : « Eventuellement, je suis disponible pour que vous veniez me raconter quelque chose », ça permet au patient de venir au moment où il est prêt à changer. Jean-Claude dit avoir été frappé par la discordance entre le vécu de la personne et celui de l’entourage qui veut toujours bien faire. Quand ce n’est pas son moment ce n’est pas son moment.
A travers ces échanges se signale la complexité du travail des professionnels face aux situations difficiles, ils doivent se concerter sans négliger la responsabilisation de la personne. C’est un travail essentiellement relationnel, or ce qui est de l’ordre du relationnel a tendance à être abandonné. « Dans ces situations, témoigne Brigitte, je m’inscris toujours dans un travail partenarial, je peux venir en appui à mes partenaires et ils peuvent le faire également. Il y a des psychiatres qui acceptent de recevoir des situations malgré leur planning surchargé. Mais des fois on n’a même pas le temps de passer des coups de fil. » Ainsi existe-t-il un profond malaise chez les professionnels ne disposant plus du temps nécessaire aux soins de la personne alcoolique : « On n’arrive pas à tout caser dans une même journée. On ne fait pas notre travail de façon qualitative, on priorise. On est tout le temps en train de se dire : « Qu’est-ce qui va être prioritaire ? Qu’est ce qui ne va pas l’être ? » Ce qui est constaté dans le social l’est également dans le soin. Magali en témoigne par rapport à l’urgence, l’équipe priorise une action parce qu’elle la considère très importante et au moment de la mettre en place une autre actualité brulante s’impose priorisée à son tour au dépens de la première. « On est sensé traiter les passages à l’acte et en même temps, on risque sans cesse d’être nous-même dans le passage à l’acte. On ne réfléchit plus, on fait les choses parce qu’il faut les faire. » On ne peut banaliser la pression dont les professionnels sont l’objet dans les difficultés à traiter correctement les patients alcooliques.
Franchi ce pas vers le soin, chacun de nos patients a pu accomplir son propre parcours. Aline a rencontré le spécialiste : « Le psychiatre que j’ai vu était extraordinaire, il m’a redonné confiance en moi. » Elle lui expose sa culpabilité de ne pas avoir protégé sa fille, de ne s’être rendu compte de rien. Un cancer vient en outre de lui être décelé : « Il m’a dit que peu de personnes pourraient endurer tout ce que j’endurais. J’avais besoin d’entendre ça. Il avait des phrases qui étaient rassurantes. Il m’a apporté de la reconnaissance, car les choses de la vie m’ont amené à me dévaloriser. » Un suivi s’est mis en place, chaque semaine elle rencontrait le psychiatre et recevait deux fois la visite d’un infirmier : « Il ne parlait pas nécessairement d’alcool, mais de choses et d’autres, c’était une conversation amicale on parlait du quotidien. J’étais contente de le voir arriver. On pouvait échanger sur l’évolution de ma pathologie. Je trouvais ça très bien parce que n’étant pas vraiment un ami ou un membre de ma famille, je pouvais lui dire ce que je voulais. Je pouvais me mettre en avant ou bien au contraire dire que je n’allais pas bien. J’avais à nouveau l’impression de rentrer dans une vie normale, il y avait un regard qui n’était pas accusateur d’être alcoolique, un regard bienveillant. » L’épisode vécu par Aline n’a pas été très long et elle n’a pas eu besoin de faire de cure, ni d’interrompre son activité professionnelle.
Passé le choc de la rencontre avec son image dans la glace, Charles va prendre une mesure radicale dangereuse. C’est un 23 décembre, il se lève, il vomit et décide de tout arrêter : « J’ai été malade, je tremblais, j’ai arrêté tout seul. J’ai tout arrêté, j’en ai plus touché. » Pendant quatre jours, il ne prend rien : « J’ai cru que j’allais mourir. » Le 7 janvier, il appelle son médecin qui l’engueule d’avoir pris un tel risque sans lui en parler. Il ne l’envoie pas à l’hôpital considérant qu’il peut à présent s’en sortir seul : « Depuis ce jour-là je n’ai pas touché d’alcool même dans un chocolat. » En milieu agricole, Brigitte a connu des cas semblables : « Il y en a qui font le sevrage tout seuls dans de pires conditions, les équipes de secteur font ce qu’elles peuvent, elles ne peuvent pas assurer une vigilance suffisante. Pour le médecin c’est très difficile également. On a un vrai souci de prise en charge de la problématique alcool en milieu rural. On a des exploitants qui sont décédés pour des sevrages intempestifs. » En revanche Christian a fait trois tentatives de soin. Il garde un souvenir cuisant d’un séjour dans le service de gastro d’un hôpital non spécialisé dans ce type de traitement : « Les alcooliques sont traités comme des chiens ». Il a ensuite vécu deux cures dans un centre spécialisé. La première a duré 5 semaines, mais 6 mois après, il a replongé. Malgré sa déception, il y est retourné, l’infirmière n’a pas été étonnée de le revoir : « Vous n’étiez pas prêt. » Grâce à cette deuxième cure, il a arrêté de boire.
Jean a connu de nombreuses tentatives de soin, de cette longue expérience sa mère conserve un souvenir très critique : « C’est d’une brutalité inimaginable les cures. Une personne de bonne volonté qui décide de faire une cure, de faire l’effort énorme de supporter une cure, on le met dans une chambre et on lui coupe l’alcool. Evidemment on l’abrutit avec des neuroleptiques, on ne peut pas faire autrement sinon c’est le délirium. Donc on met cette personne hors de sa propre responsabilité tellement il est drogué, donc il n’est plus acteur de son soin, il est une chose. » Et pour quel résultat : « Chaque fois à peine sorti il est allé s’acheter une bouteille de whisky ! » La répétition des insuccès de son fils pour se libérer de l’alcool malgré ses efforts pour supporter la brutalité des cures de désintoxication la laisse perplexe. Elle constate qu’aucun suivi médical et psychologique n’est assuré au retour des cures de désintoxication en hospitalisation, il est brutalement lâché chez lui après avoir été déresponsabilisé par la prise de drogues et de neuroleptiques. Elle critique également les règles draconiennes de certains centres spécialisés qui exigent que le malade affirme à plusieurs reprises par téléphone sa volonté de faire une cure, condition impraticable pour une personne qui a perdu la notion du temps, comment se souvenir qu’il doit téléphoner tel jour à 15h ? Donc il ne remplissait pas les conditions pour le prendre.
Martine a été révoltée par la façon dont elle-même a été traitée. Tout essai de contact de la part de la mère avec les soignants est repoussé. Elle exprime son ressenti d’inutilité à ne pas trouver sa place au côté de son fils. Ce qui est incompréhensible pour elle c’est l’ignorance dans laquelle les soignants sont de l’environnement immédiat du malade. Ils appliquent des protocoles standards sans prendre connaissance de l’étude du milieu du patient : « Il est évident que le soin pour chaque personne doit être très documenté : dans quel milieu il vit ? Où il est ? Et ça, ça n’est pas fait. » Et qui plus est ce qui la révolte, c’est l’absence d’attention dont sont l’objet les proches : « Eux aussi ils auraient besoin qu’on les aide à comprendre, que les parents en particulier la mère, que ce n’est pas de sa faute, une aide qui permet aux aidants de tenir le coup. Ils ont un rôle important et ils sont complétement isolés, on s’en méfie comme du feu. »
Martine veut faire entendre son expérience aux soignants. Peut-on raisonnablement laisser les proches dans l’ignorance de ce qui concerne l’alcoolisme et plus généralement l’addiction. Les cures provoquent des douleurs physiques et psychologiques qui exigent de la part du malade un immense courage. Pour l’aider à les accepter, elles devraient être accompagnées d’encouragements et de mise en valeur de l’effort consenti. C’est là aussi que les proches auraient toute leur place au côté des thérapeutes. Encore faudrait-il qu’on les aide à dépasser la période d’incompréhension devant l’alcoolisme. « Si l’addiction alcoolique ne peut être soignée sans le désir du patient, mon expérience personnelle, affirme-t-elle, m’a persuadée que le chemin du malade est indissociable de celui de son environnement proche. » Une éducation des aidants devrait entrer dans la prise en charge générale du patient. Elle abrègerait les temps d’errements, soulagerait des souffrances et apporterait indirectement un soutien psychologique aux malades.
Magali, psychologue, répond aux récriminations de Martine. Elle abonde dans son sens, il est impossible, en effet, de concevoir le soin en addictologie sans faire une place à l’entourage. La plupart de ces lieux de soin permettent qu’une parole soit donnée aux proches des usagers. Les soignants reçoivent ces témoignages « avec beaucoup de modestie dans leur capacité à soulager cette souffrance » quand elle arrive à se dire. L’hôpital de jour est un dispositif qui permet de rester en lien avec sa famille : « si on n’écoute pas la souffrance de l’environnement, de la mère on se complique la tâche. L’institution n’est pas le lieu de vie de l’usager. Si on n’entend pas ce qui se passe à la maison, c’est plus compliqué. A Nantes il y a des consultations pour l’entourage, nous recevons des conjoints, des frères et sœurs, des enfants : « Là, précise la psychologue, je ne vois pas l’usager et quand je vois l’usager je ne vois pas son entourage. » Pour être précis, il faut que les espaces soient séparés. C’est peut-être pour ça que l’entourage s’entend dire : « Je ne peux pas vous répondre ». Mais ça ne doit pas empêcher d’entendre cette souffrance. Ça peut être vécu comme un rejet. Ça fait d’ailleurs partie des missions officielles du CSAPPA et au CHU les professionnels s’adaptent à la demande de l’usager. Ils pratiquent des entretiens familiaux qui ne sont pas de la thérapie familiale. On peut faire des suivis parfois longs d’une personne de l’entourage.
Le temps du soin
Hospitalisation de jour ou cure, avec ou sans recours au sevrage, en addictologie la mise en œuvre des soins soulève des questions organisationnelles qui ne favorisent pas toujours la volonté du patient de se soigner lorsqu’elle se déclare. Magali en témoigne : « Quand vous dites : « c’est le moment », il faut que ça s’enclenche c’est là qu’on pourrait avoir une difficulté. Entre la temporalité de l’usager et la temporalité institutionnelle. A Nantes on a une liste d’attente de cinq mois. Alors on fait des montages, on essaie de faire patienter les gens. On essaie de les voir pour maintenir une alliance pour qu’il n’y ait pas d’effondrement, c’est très compliqué. Il y a des moments où on sent que quelque chose se passe mais pour voir le médecin c’est parfois plusieurs mois d’attente, après c’est l’entretien préalable. On sollicite les soins somatiques pour les sevrages, c’est-à-dire la gastro et on organise des suites de soins dans les établissements, quelque chose qui tient dans la durée, avant l’hôpital de jour, etc… »
Le patient est soumis à cette attente, Christian se souvient de cette terrible attente qu’une place se libère, il a attendu 10 jours, le médecin avait dit à sa femme qu’il ne fallait pas le sevrer au risque de crises d’épilepsie : « C’était terrible, ma femme m’apportait une bouteille de Ricard tous les midis et je buvais ma bouteille, ça a duré 10 jours. C’était épuisant pour elle et pour moi. » C’est aussi un problème d’organisation, ça a un coût financier, sans compter la culpabilité de la personne qui dit : « Je m’en vais. » Cette situation est exemplairement critique dans le milieu agricole. Brigitte la vit régulièrement, il faut anticiper, coordonner médecin, centre de soin, environnement familial et professionnel, car c’est eux qui vont assurer la continuité de l’entreprise. Les enjeux sont très sérieux pour une entreprise agricole, l’exploitant ne peut pas quitter son poste quand il veut : « C’est le moment mais je ne peux pas le faire avant deux mois quand j’aurai fini les vêlages ». Et les structures de remplacement sur ces périodes-là ont un coût très important. Quand on dit : « c’est le moment », il faut prévoir le remplacement ça va mobiliser tout un environnement sans culpabilisation. Brigitte précise que les mutuelles ont des limites en raison de l’agrandissement des exploitations : « Il faut à la fois mobiliser du monde, des énergies, de l’argent. Des fois ça ne fonctionne pas, mais des fois ça fonctionne. »
Christian explique le déroulement de sa cure : « Ils nous font souffler dans l’éthylotest pour voir notre taux, à 9h je devais être à 2gr. Ils nous mettent dans une chambre, ils prennent la tension ils nous enlèvent le parfum, l’eau de Cologne après ils nous donnent des médicaments, je suis resté deux jours en chambre, parce que je ne pouvais pas boire évidemment. Le sevrage c’est terrible, j’ai eu des transpirations énormes, ça a duré 48h. J’avais des odeurs de transpiration infectes. » La cure dure 5 semaines, les 15 premiers jours sans sortie, ensuite le weekend. Le programme comprend des groupes de paroles et des ateliers. Les curistes ont l’écoute des soignants et ils peuvent consulter un psychologue. Après la sortie, les patients peuvent avoir un suivi tous les mercredis. Grâce à cette deuxième tentative, il a arrêté de boire, il conserve un vif souvenir des sevrages au point d’en avoir longtemps fait des cauchemars avec la peur de reboire et d’en subir à nouveau. Christian a apprécié la façon dont les patients sont traités et responsabilisés.
Le traitement des addictions est en effet très contraignant, ne serait-ce que dans la durée (entre 3 à 4 semaines). Des programmes plus ou moins élaborés sont pratiqués parallèlement aux soins médicaux, une place importante est donnée aux thérapies de groupe et médiations diverses. « Au sein de l’hôpital de jour dans lequel j’exerce, rapporte Magali, a lieu chaque vendredi, une médiation groupale offrant aux personnes hospitalisées l’occasion de faire part de leur vécu du soin, de leur expérience de la vie communautaire au sein du groupe des soignés, des inquiétudes qui émergent à la veille du week-end et de toutes les suggestions qu’ils pourraient faire aux soignants dans le cadre d’une posture que nous souhaitons active vis-à-vis du fonctionnement de l’unité. »
Geneviève a été infirmière psychiatrique au SHALE de La Rochelle, service au fonctionnement inspiré de celui du CALME (Centre Aide à la Libération des Malades Ethyliques) à Cabris (06), créé à l’initiative d’un médecin, ancien alcoolique. Par-delà la prise en charge médicale (examens cliniques, sevrage, suivi.), les séances de relaxation (centrées sur le vécu du corps) et les psychothérapies de groupe, l’infirmière témoigne de l’esprit dans lequel cette institution a été pensée. La Maison, ainsi que soignants et soignés nomment le centre, est organisée pour favoriser les liens de confiance et la responsabilisation individuelle. Tout au long du séjour le curiste est accompagné en particulier pendant le sevrage durant lequel un anxiolytique (valium pour éviter les crises d’épilepsie) lui est prescrit. L’alcoolique est invité à devenir spécialiste de sa maladie, des cours médicaux lui sont dispensés avec des informations sur le cerveau, sur les mécanismes de la dépendance et les risques de détérioration liés à l’alcool. Au plan personnel, il lui est suggéré d’ouvrir des pistes de travail sur sa propre histoire et sur ce que l’alcool est venu soulager. Des outils sont mis à sa disposition, « Par outils, précise Geneviève, il faut entendre un ensemble de clefs, de réponses que le curiste aura intégrées durant son séjour et qui lui seront utiles dans son retour à la vie ordinaire. Chaque fois qu’une tentation, un danger surgira, la personne pourra puiser dans son arsenal de solutions des réponses qui l’armeront contre les risques de rechute. » Ce programme va jusqu’à susciter une réflexion métaphysique : « Comment oser être ce que l’on est. » Durant le séjour le curiste peut ainsi acquérir des connaissances et il apprend à organiser sa vie face aux risques encourus. Tout ce qui se vit dans l’établissement est matière à réflexion et source de travail individuel et collectif. A noter que chaque semaine une réunion institutionnelle est ouverte sur l’extérieur, elle accueille les familles, les amis des curistes, de futurs et anciens curistes et des professionnels (médecins, infirmiers, assistantes sociales, travailleurs sociaux).
« La visée fondamentale de notre travail en tant que psychologues, éducateurs, médecins, infirmiers, soignants et accompagnants en général, se construit autour de la facilitation des processus d’autonomisation, et ce, quel que soit le profil des personnes que nous rencontrons. » Cette visée clairement énoncée par Magali fait défaut dans certaines prises en charge. Dans certains services où les personnels ne sont pas formés à l’accueil de ce type de malade, les représentations dévalorisantes sous-tendent quelques fois les attitudes des soignants. Annick rappelle le vécu d’infantilisation dont souffre la personne alcoolique : « On a une mauvaise image de soi et en plus on est infantilisé, on vous prend le portable et on vous coupe de tout et de tout le monde. » « Dans le problème de l’alcool, on redevient un enfant, observe Geneviève. Quand on a trop bu, on a besoin d’être relevé et on devient complètement dépendant. Il ne faut surtout pas retrouver ça dans les soins, d’être dépendant d’un adulte, un référent qui est supérieur, il faut que la personne reprenne sa place d’individu. » Et Magali de souligner cette ambiguïté : « Est-ce que ce n’est pas une tendance pour les soignants d’infantiliser et aussi pour les soignés de s’infantiliser ? Est-ce que ce n’est pas un risque des deux côtés ? » Les témoignages sont unanimes à souligner l’importance du regard que l’autre porte à la personne alcoolique et du discours qu’il lui tient. S’il faut du courage, de la volonté, un entourage bienveillant, c’est cette parole qui restaure sa dignité qui l’aide à s’arracher à son état de loque : « Le psy m’a redonné confiance en moi, le fait que je valais quelque chose » dit Aline.
Lorsque l’infirmière dit à Christian : « On était à peu près sûres que vous reviendriez », elle exprime une évidence de soignante expérimentée : il n’était pas prêt. Cette évidence pour elle mérite d’être soulignée, tant il est vrai que la libération de la dépendance demande du temps et que les tentatives de soin ne doivent pas se compter. Nul patient ne doit s’arrêter sur ce qu’il peut considérer comme un échec. Les soignants l’expriment à l’envi : « A chaque fois, il se passe quelque chose ! Quelque fois, témoigne Geneviève, quand il y a eu une injonction de soin, le patient n’a pas eu le choix et malgré cela il se passe quelque chose. Après la personne va venir avec son vrai désir de soin. ». Magali a la même expérience : « Ça peut être vécu comme un échec, j’entends les patients dire : » J’ai rechuté, je repars à zéro « , on leur dit : » Non vous ne repartez pas à zéro « . On essaie d’interroger : » Qu’est ce qui s’est passé cette fois ci ? » En tant que soignant on tente de pointer les paradoxes, c’est des choses qui se digèrent assez lentement. Il y a toujours un après coup : « on m’avait dit ça, je n’ai pas compris sur le moment mais ça y est je peux faire un pas » ». Les soignants savent que ces traitements s’inscrivent dans un processus long, parfois haché, mais lors duquel des avancées se font.
Martine ne demande qu’à croire que ces longues épreuves douloureuses peuvent conduire à la guérison. Une récente prise en charge en hôpital de jour, à l’initiative de Jean, a donné des effets significatifs. Il a trouvé un lieu où il y avait suffisamment de liberté et de tolérance avec l’alcool, la personne arrivait sans avoir à dissimuler qu’elle avait bu, ce qui évitait le mensonge. C’est « un milieu d’entraide entre patients, respectueux des personnes et sans aucun jugement ». C’est la seule fois où il ne s’est pas remis à boire le soir même. Cette prise en charge lui a permis de réaliser la gravité de son état physique et il est maintenant dans le désir de reprendre sa vie en main.
Le retour à la vie normale
La postcure n’est pas un passage garanti vers un retour à la vie dite normale. Certaines tentatives échouent parce que l’après n’a pas été préparé, pensé. Au niveau médical, le généraliste déplore une absence d’informations, de compte rendu : « Untel a été hospitalisé de telle date à telle date », ça ne va pas au-delà. Qu’est ce qui a été travaillé, qu’est-ce qui ne l’a pas été ? Il faut avoir des liens personnels avec les équipes de secteur, un psychiatre ou deux pour avoir un retour, il faut aller à la pêche, ça demande une énergie folle. » Le retour des équipes spécialisées est difficile. D’autant comme le souligne la psychologue que : « Quand on arrête le produit, la dépendance se joue autrement, ça n’a pas disparu comme par magie. » Brigitte insiste sur l’accompagnement familial, à l’exemple de cette femme qui reconnaît qu’au retour de cure de son mari, elle casse la démarche : « Elle a eu besoin d’en parler, elle avait peur de ses réactions. Elle a dû engager un travail avec une psychologue. » Il faut en outre aider ceux qui en sont sortis à retrouver leur place, il faut qu’ils reprennent les initiatives. Au titre de conseillère elle vient en appuis sur plusieurs points, en particulier au niveau financier.
Le changement suscite des réactions paradoxales, ainsi constatées par Magali : « Quand une démarche de soin a été décidée par la personne, alors que l’entourage la demandait depuis longtemps, ça bouleverse tellement les rituels et les habitudes que ça met le bazar, il y a des proches qui pourraient presque dire : « je préférais avant ! ». Parfois c’est compliqué : « Avant je devais faire plein de choses mais au moins jetais tranquille ! » Lorsque l’on fait disparaitre la conduite addictive, ça apporte des changements, mais ce n’est pas seulement arrêter de boire, c’est aussi un autre rapport au monde. » Ainsi que l’a constaté Geneviève, cette décision peut amener d’autres personnes à décider de soins. C’est le cas chez les adolescents. Les parents amènent leur enfant pour des problèmes d’alcool ou de cannabis et ça peut les amener à se questionner également sur les questions d’addiction.
Lorsque la menace de replonger s’est éloignée, avec le recul, les personnes abstinentes expriment la souffrance éprouvée lors de la maladie : « Mes souffrance physiques chroniques, c’est presque rien à côté de ce que j’ai souffert, déclare Aline. C’est comme un démon, on est seule face à ses démons. C’est quelque chose qui est là toute la journée qui titille. Aller au travail, être propre, c’est des périodes sombres de ma vie, j’ai encore du mal à en parler. Je ne veux pas replonger dans ce que j’ai vécu, mais aider des personnes qui sont en train de le vivre oui. » Sans oublier la violence du traitement : « J’ai arrêté l’alcool, j’ai arrêté le tabac, le tabac c’est de la rigolade, c’est rien du tout » rapporte Christian. Il en résulte la fierté d’avoir vaincu un monstre redoutable : « Quand on s’en sort, on s’en sort grandi, on est plus fort, on a affronté quelque chose qui était difficile, qui était un combat. Je ne pense pas que dans ma vie quelque chose me fasse descendre aussi bas. J’arrive à affronter des épreuves en me disant que ça ne peut pas être pire. »
Une vie normale se dessine alors, non exempte d’obstacles : « C’était compliqué, témoigne Aline, au début j’allais au supermarché parce que j’avais envie d’acheter du whisky, et après quand j’y allais j’évitais tous les rayons où il y avait de l’alcool. Je les évite toujours. Aujourd’hui, je me sens assez forte pour ne plus en consommer. Il me reste cette angoisse du soir, mais je refuse toutes les invitations. J’ai peur de ressombrer, d’être à nouveau tentée. » Christian a repris ses activités de loisir, la chasse, le foot avec mon fils : « Avec mes enfants maintenant on en rigole, c’est quelque chose de passé. Je n’ai plus peur du regard des autres, je vais dans les manifestations, je bois un Perrier. Avant je disais : « Je ne bois plus d’alcool, maintenant je dis : Je ne bois pas d’alcool. Ce n’est pas pareil. » C’est du combat, c’est dur, c’est tellement dur de s’en sortir qu’on a la crainte de retomber. On a tout le temps une épée de Damoclès sur la tête. » Charles a appris à dire non : « Quand on veut s’en sortir faut apprendre ce mot-là. Je buvais un café au lieu d’un Ricard au bistrot. Savoir dire non. » Il en conserve un dégoût de l’alcool : « Ça m’effraie, l’odeur c’est horrible ! Quand je prends des médicaments je demande s’il y a de l’alcool dans la composition. » Il a repris le sport, qui plus est, il dit avoir récupéré la mémoire en lisant. Jean n’en est pas sorti, mais il arrive à parler de son problème dans le cercle familial, il ne le cache plus. Vis-à-vis de l’extérieur, il conserve encore quelques stratégies. Il a moins peur du jugement. Aujourd’hui la situation est moins douloureuse.
Nos témoins nous disent l’incommensurable difficulté à se libérer de cette dépendance pour qui ne l’a pas vécue. Ils nous font entendre la terrible souffrance physique, les cauchemars qu’elle génère à l’idée de revivre un sevrage. Ils nous font partager ce sentiment de honte, d’infériorité, de déchéance sociale. En revanche le courage requis pour en sortir leur donne la force de témoigner, un élan de solidarité sans nul autre pareil à l’égard de ceux qui sont dedans. Nous avons rencontré cette volonté de venir en aide à ceux qui vivent ce calvaire : « Aujourd’hui pour moi c’est douloureux, avoue Aline, mais je suis là si ça peut rendre service à quelqu’un, je ne suis pas venu ici la fleur au fusil. J’ai vraiment pris sur moi pour être là car ça me replonge dans une période très noire de ma vie. C’est très difficile de sortir de cette dépendance à l’alcool ça fait deux nuits que je ne dors pas. Parce que je sais que je vais venir ici et reparler de cette longue descente aux enfers et de cette longue remontée vers quelque chose. Je peux comprendre qu’il n’y ait pas beaucoup de témoin car il faut savoir que pour nous c’est très douloureux. » Cet élan de solidarité se comprend comme une reconnaissance à ceux qui leur ont permis d’en sortir, une dette : « Quand mon médecin m’a demandé de participer à ce groupe avec ce qu’il a fait pour moi, je me devais de le faire. J’ai été aidé par mon médecin, par ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents à l’époque, ma sœur, mon beau-frère, mes neveux. Ce qu’on nous a donné, il faut le redonner. A un moment on n’était pas bien mais pour moi, ce n’est pas une tare. On ne s’est pas rendu compte, on a fait du mal à notre famille, il ne faut pas se culpabiliser. »
Ce très vif désir d’aide passe par la participation à des groupes de paroles dans des associations, il passe aussi simplement par le conseil à une personne mal engagée d’en parler : « Qu’on en parle on a fait 50% du travail ». Aline rapporte cet exemple : « J’avais une amie, je me rendais compte qu’elle tombait dans l’alcool et qu’elle le cachait. Elle avait toujours des grands sacs avec de la salade au-dessus et les bouteilles en dessous. Son sac était tellement lourd que ça ne pouvait pas être le poids des salades ! Je connais bien la démarche, j’ai vu dans quoi elle était embarquée. Je me suis permis de lui raconter mon histoire. Je lui ai parlé de mon appétence pour l’alcool et que si elle voulait m’en parler, elle pouvait le faire. Et un jour elle s’est décidée de venir me parler de son histoire. Et là je suis très fière de moi, ça fait maintenant 4 mois qu’elle est sortie de l’hôpital, elle n’a pas rebu et elle va bien. Les gens qui n’ont pas connu cette dépendance ne comprennent pas le sentiment de honte. Je pense que les personnes qui peuvent le mieux aider les personnes alcooliques ce sont les anciens alcooliques eux-mêmes. »
Ce groupe que nous avons constitué, les témoignages que nous avons recueillis nous offrent un horizon possible pour s’arracher à cet enfer. Nous avons constaté l’importance de l’entourage, l’incontournable prise de conscience pour sortir du déni, la nécessaire capacité à mettre des mots sur ce mal honteux, les indispensables ressources personnelles qui soutiennent la volonté et le courage d’affronter les soins afin de reprendre sa vie en main. C’est en effet un horizon possible, mais nous ne pouvons négliger que les personnes qui nous accordé leur confiance pour livrer leur vécu d’alcoolique ont précisément bénéficié de ces conditions favorables. Au moment de conclure, nous nous devons d’avoir une pensée pour les nombreux malades de l’alcool, les personnes isolées qui n’ont pas cette chance de rencontrer les conditions propres à leur rendre leur dignité. En cela, il ne serait pas honnête d’ignorer la responsabilité sociétale dont Jean-Claude se fait le porte-parole : « Aujourd’hui nous acceptons d’être confinés contre un risque infectieux qui est le risque de tout être vivant. En comparaison regardons ce que l’organisation mondiale de la santé dit de l’alcool. Il apparait qu’un décès sur dix-sept dans le monde est lié à l’alcool, pour les hommes un sur treize, pour les femmes un sur vingt-cinq. Nous allons admettre que nous devons porter un masque en public que nous devons accepter des règles de distanciation sociale, ne pourrions-nous pas réfléchir au fait que nos discours complaisants sur la convivialité et sur les vertus de tel ou tel alcool vont entraîner la mort dans notre tribu, disons, d’une cinquantaine de personnes, (amis famille, collègues) de trois personnes. »
C’est par ces quelques considérations qu’Alain conclut ces échanges : « Quand j’étais très jeune que j’ai commencé mes études de psychiatrie, je me suis occupé de personnes qui avaient des soucis avec l’alcool, le traitement de ces personnes, le côté relationnel tel que je peux l’entendre aujourd’hui tel que vous en avez parlé, il n’en était pas question. C’était cette violence dont vous parlez, cette punition, cette culpabilité. Ce que j’entends aujourd’hui à travers vos témoignages singuliers c’est que beaucoup de choses ont changé. Je vois ici qu’il y a le souci de la parole, de votre parole, de la parole du patient qu’il n’y avait pas avant, peut-être parce qu’on n’avait pas compris ce rapport au mensonge. Le côté relationnel tel que vous l’avez décrit ça n’existait pas, on considérait la parole de ces personnes comme d’aucune valeur. Les choses ont beaucoup changé dans l’attention, la compréhension, dans l’humain. Cet humain est menacé semble-t-il, il n’est pas menacé par la bonne ou mauvaise volonté des uns ou des autres, il est menacé par quelque chose qui s’apparente aux sociétés modernes qui sont axées sur le profit au plan comptable, des choses comme ça qui privent les soignants de ce qui pourrait les animer avec les patients. C’est l’enseignement que je tire de cette rencontre ».
Dans notre étude consacrée aux relations entre patient/usager et professionnels, la problématique de l’alcoolisme nous livre des particularités étrangères à d’autres. La première et non des moindres est le déni de la maladie, cette position qui fait de l’alcoolique son meilleur ennemi. Il cache et se cache qu’il est dépendant et en pleine détérioration physique et psychique. Dès lors que la prise de conscience vient le sortir de son aveuglement, il se trouve face à la difficulté de s’en libérer et d’abord d’en parler en raison de la honte que lui inspire son état aux yeux des autres. Il va alors exemplairement nous montrer que sa détermination est la seule clef possible pour assumer la violence que les sevrages vont infliger à son corps. Le traitement de l’alcoolisme est certainement un des rares, peut être le seul, qui ne peut pas s’accomplir avec succès sans que le sujet soit déterminément acteur de sa démarche. Le deuxième enseignement, concerne les soignants, il leur offre un espace de réflexion professionnel sur l’apprentissage du respect absolu du rythme du patient s’il veut recueillir son adhésion, sa pleine participation aux soins en vue de la meilleure issue possible de la maladie et à son risque de rechute.
Avec nos remerciements à Aline, Brigitte, Charles, Christian, Geneviève, Jean-Claude, Magali et Martine pour leurs précieux témoignages.
[1] Les formules prononcées par les participants sont en italiques, les extraits de leur discours entre guillemets.