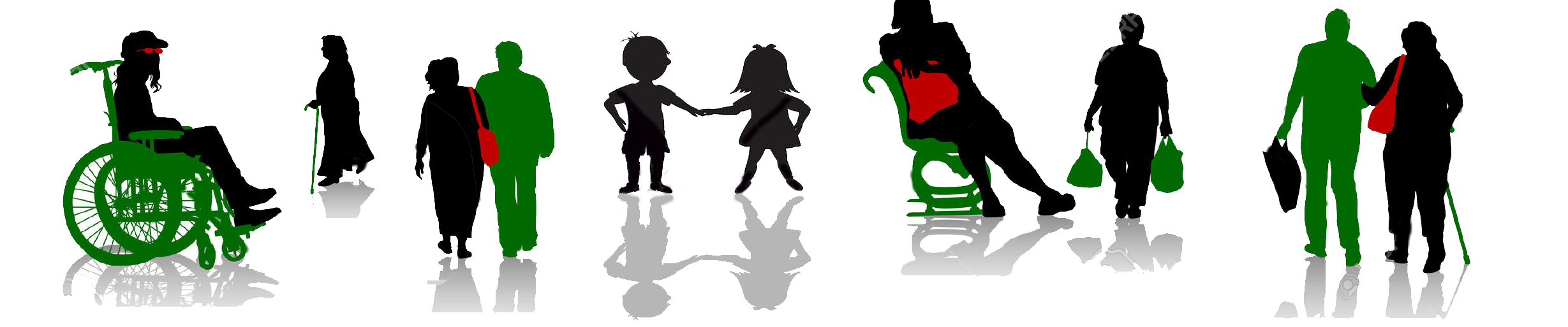« Plutôt que les racines, je cultiverais l’ailleurs, un monde qui ne se referme pas,
plein de ‘’semblables’’, différents, comme soi pas comme soi. »[1]
Barbara CASSIN
La reconnaissance mutuelle en acte.
Dès leur arrivée à Robben Island, Nelson Mandela et ses compagnons de détention se préoccupèrent de savoir s’il leur serait permis de faire des études. Lors de sa captivité Nelson Mandela s’inscrit à un cours par correspondance afin d’étudier l’Afrikaans, la langue de l’ennemi. Ses camarades de détention ne manquent pas de s’en offusquer ! S’ils conçoivent aisément que leur chef se nourrisse d’ouvrages sur l’Art de la guerre, ils se moquent de lui pour l’intérêt qu’il porte à la langue de l’oppresseur[2]. Loin d’être affecté par ces critiques, Mandela se plonge dans leur littérature, il apprend des poèmes, s’immerge en profondeur dans la culture des Afrikaners, se passionne pour leur histoire. Il dira combien les œuvres de Nadine Gordimer lui ont « beaucoup appris sur la sensibilité des Blancs libéraux »[3]. Mandela a également le souci d’initier le peuple Noir à l’histoire des Afrikaners. Il demande à ses codétenus de faire comme lui d’étudier l’histoire, la langue et la culture des Afrikaners. Au point de voir qualifier la sinistre prison d’Université Robben Island !
Dès ses premières rencontres[4] avec les représentants du pouvoir, Mandela est saisi par leur absence de culture nationale. Les plus cultivés sont eux-mêmes imprégnés du discours de propagande et mésinformés sur les plus belles pages de leur propre histoire. A chacune de ses rencontres, Mandela impose un préliminaire, il n’a de cesse que de remettre en perspective l’histoire du peuple noir africain, de la création de l’ANC, de la Charte de la liberté…, tout autant que de rappeler à ses interlocuteurs leur histoire d’immigrés venus d’Europe s’installer en Afrique du Sud. Il se montre capable de citer le nom de glorieux généraux qui se sont illustrés lors de la guerre des Boers contre les troupes de l’Empire britannique. Il leur expose comment ils se sont ardemment battus pour mériter de vivre sur cette terre. Un préalable à tout échange politique par lequel il les conduit à prendre conscience de l’histoire et de la place des Noirs africains, tout en leur reconnaissant sans ambiguïté ce même statut d’Africains.
Mandela est convaincu qu’il ne peut affronter son adversaire avec succès que s’il le comprend parfaitement. Il serait cependant erroné de penser que cet effort pour connaître l’autre n’a pour seul objectif que de le vaincre. C’est bien au-delà que Mandela se projette, il a acquis la certitude que ce cheminement est la condition incontournable de son projet de réconciliation parce qu’il sous-tend la capacité à vivre ensemble. Connaître son adversaire pour mieux le combattre certes, mais aussi pour s’identifier à lui et l’associer à la victoire. Dans la solitude de son cachot, Mandela a appris à dépasser la haine et à renoncer à la vengeance. Son projet d’avènement d’un état démocratique multiracial suppose la reconnaissance et l’acceptation de toutes les différences ethniques et de leurs langues.
Cette profonde intuition humaine va ouvrir la voie à la mise en œuvre de la généreuse commission : Vérité et réconciliation. Lorsque l’on connait la violence sanglante que subit le peuple africain par ses déchirements raciaux et que l’on assiste en 1994 au spectacle de ses interminables files venues répondre à l’appel de la création d’un état démocratique multiracial, on mesure le chemin parcouru. Le ressort de ce miracle réside à n’en pas douter dans cette opiniâtre quête de la reconnaissance de l’altérité qui anime Nelson Mandela. Loin des terribles exactions commises dans cet état en guerre, cette leçon doit nous conduire à une profonde réflexion sur les malentendus, les divisions, voire les ruptures qui troublent les relations entre des acteurs, pourtant bien intentionnés, au service des personnes vulnérables.
La vie relationnelle collective pluridisciplinaire fait régulièrement résonner la déclinaison : méconnaissance, connaissance, reconnaissance. Au nombre des causes de dysfonctionnement d’un collectif pluridisciplinaire, il est régulièrement observé la méconnaissance dont souffrent ses acteurs. Le constat est sensible à l’intérieur même d’une équipe dont les membres ont pourtant des relations directes. Si l’on prend l’exemple des missions : elles peuvent être mal définies, ce qui est de la responsabilité du Directeur des Ressources Humaine ; elles peuvent être mal identifiées, mal connues, mal comprises des uns et des autres, ce qui relève du chef de service ou du coordinateur, enfin elles peuvent ne pas être respectées, ce qui incombe aux praticiens eux-mêmes. De quelle place chacun parle-t-il et agit-il ? Quel est son champ de compétence ? Que recouvre sa tâche dans l’équipe ? Pour le dire plus simplement en quoi son métier consiste-t-il ? Est-il bien identifié par ses collègues ? Le manque de lisibilité de la fonction de chaque intervenant entraine des confusions chez les usagers et génère des tensions chez les professionnels.
Le problème devient beaucoup plus épineux dans les rencontres entre équipes différentes, car s’ajoute la méconnaissance de la mission de chacune, de son agrément, de son orientation méthodologique, voire de son histoire… Deux équipes répondant au même agrément peuvent avoir des fonctionnements, des pratiques, voire des philosophies très différentes. L’absence de relations directes favorise des représentations erronées qui polluent les rapports professionnels. La banalité des malentendus et des conflits qui en découlent nous fait oublier que nous touchons certains ressorts déterminants de la mésentente : celui d’abord de la nécessaire identification de chaque acteur et de chaque équipe, celui ensuite de l’acceptation de l’altérité au sens personnel mais aussi professionnel.
Par-delà le simple niveau de reconnaissance, dès lors qu’une altérité professionnelle est reconnue, se pose la question de ce que ces différents protagonistes ont à partager. La rencontre pluridisciplinaire est fondée par l’accompagnement d’une même personne par plusieurs acteurs dont chacun a un témoignage, pour ne pas dire une expertise à apporter. C’est à une mutualisation de savoir que le collectif est conduit à opérer. Ce pose alors la délicate mise à l’épreuve d’une reconnaissance mutuelle. Identité, altérité, mutualité : trois états à explorer. La philosophie morale d’Axel Kahn, la psychanalyse de Jacques Lacan et la philosophie phénoménologique de Paul Ricœur viennent éclairer notre questionnement.
Réciprocité, altérité, éthique[5].
« Matérialiste darwinien », « agnostique irréductible », Axel Kahn ne croit pas d’avantage au déterminisme d’une divinité qu’au conditionnement par les gênes, mais il pense que l’hominisation puis humanisation[6] d’Homo sapiens sont le fruit d’un long processus d’acculturation, développé au fil du temps par nos ancêtres. Ses travaux scientifiques, son engagement social et politique n’ont jamais cessé d’être éclairé par sa réflexion morale garante de la transmission de cet héritage « …j’œuvre pour permettre à chacun de se forger son libre arbitre, gage de la qualité d’un engagement. »[7] Généticien et éthicien, l’auteur de L’homme, le Bien, le Mal articule ces trois thèmes : réciprocité, altérité, éthique qui nous projettent au cœur des questions qui animent notre collectif.
L’homme possède une spécificité dans le monde vivant, celle d’avoir des pensées qui lui donnent des ressources infinies dans la défense de ses intérêts et la préservation de son aptitude à se reproduire. Cette singularité s’observe sur deux plans. L’homme est capable d’une cruauté gratuite à nulle autre pareille dans le monde animal, mais s’il n’est pas naturellement bon, il possède conjointement une capacité à porter un regard critique sur ses pensées et sur ses actes. Comment se constitue notre sentiment du bien et du mal ? Lequel a précédé l’autre ? Comment s’articulent-ils l’un à l’autre ? Une entrée dans le parcours de Kahn qui nous ouvre à une plus ambitieuse interrogation : comment Homo sapiens s’est-il humanisé ?
Qu’est-ce qui préside chez l’homme à l’acquisition du sens du bien et du mal ? La sempiternelle question de l’inné et de l’acquis se pose inévitablement : comment situer la part des déterminations biologiques et celle des processus psychiques et culturels. Certains travaux génétiques contemporains laissent entendre une relation directe et mécanique entre les gènes et les comportements. Cette vision réductrice ne tient pas compte de la complexité du phénomène. Il est bien évident qu’il existe une base matérielle aux opérations mentales et qu’il est indispensable de la connaître. Mais cette connaissance ne nous ouvre pas à la compréhension de l’émergence de la pensée morale. Si l’on veut progresser dans ce questionnement, il convient de clairement distinguer ce qui relève du support physique, physiologique, biologique, génétique… et ce qui en est la manifestation. Si le violon est indispensable à l’interprète, ce n’est pas l’instrument qui en exhale le chant. Ce qui autorise cette affirmation : « La possession d’un génome humain est indispensable à l’émergence d’une pensée morale »[8].
L’organisme de l’homme est naturellement doté de propriétés biologiques propices au développement de ses capacités d’adaptation. Dès lors qu’elles sont activées, celle-ci stimulent en retour ce terreau originel, accroissent le nombre de neurones, démultiplient les circuits élargissant ainsi le potentiel d’adaptabilité. Dans le champ de l’acquisition des valeurs sociales qui nous occupent, des propriétés biologiques permettent et facilitent l’échange intersubjectif qui conduit à l’émergence de la pensée. Ce processus n’est cependant possible que dans une relation intersubjective entre individus. « Une potentialité pour s’exprimer doit être d’abord préservée, et ensuite développée. Lorsqu’elle n’est pas stimulée, elle s’efface, sans laisser de trace conséquente. »[9] Kahn en donne pour exemple, l’enfant sauvage de l’Aveyron. Malgré les bons soins du docteur Itard, les progrès réalisés n’ont jamais permis à Victor de s’approprier le langage des humains. Un constat confirmé par les travaux contemporains sur la plasticité synaptique.
Nous touchons là un des points les plus saillants de la thèse de Kahn : le rôle déterminant de l’intersubjectivité affirmant que l’éveil de la conscience de chacun est tributaire et indissociable de la reconnaissance de l’autre. Ce couple matriciel de l’un et de l’autre est la condition de l’activation de notre potentiel biologique permettant l’avènement de la pensée. Je ne me reconnais et n’adviens en tant que sujet que par une médiation à l’autre, inscrit lui-même dans un cadre social acculturé. Ce couple singulier se développera dans ce paradoxe de dualité et d’interdépendance : « l’autre [étant] toujours le miroir déformant mais indispensable de soi-même, condition de l’édification de toute personnalité »[10]. Cette reconnaissance inscrit l’individu dans un échange mutuel par lequel il acquiert le sens de la réciprocité. Elle l’introduit à la conscience de la valeur intrinsèque de l’autre et à son respect. Le long processus d’humanisation prend corps grâce à la réciprocité qui instaure le sens de l’altérité.
La naissance du sens moral s’inscrit dans la logique de cette dynamique psychique inter-individuelle par la prise de conscience que l’autre m’est indispensable ! Telle est la « base ontologique du sens moral lié à la nécessité de l’autre pour la conquête de soi. »[11] Ce fondement déterminant pour l’évolution de l’humanité ne nous exempte pas du mal. Pour Kahn le mal est propre à l’espèce humaine, il est même la condition de la pensée morale. C’est parce qu’il peut commettre des actions mauvaises dont il peut même tirer de la jouissance que dans un impératif de préservation l’homme est conduit à l’invention du bien. Ainsi malgré notre inclinaison à servir nos intérêts, nos désirs et nos pulsions, nous disposons de cette capacité à nous interroger et d’évaluer nos actions à l’aune des préjudices que nous apporterions à autrui, au risque en outre de la culpabilité. L’auteur de Un type bien ne fait pas ça… définit ainsi le bien : « J’appelle Bien tout ce qui procède de la pensée, et des actions qui en découlent, ayant comme objectif de préserver l’humanité de l’autre en ce que je la reconnais équivalente à la mienne propre. »[12] Nulle action morale n’existe hors de la reconnaissance de la valeur de l’autre similaire à la mienne. Pratiquement, par-delà sa valeur intrinsèque, une action n’est morale que lorsqu’elle prend en compte l’intérêt qu’elle a pour soi-même et les conséquences qu’elle peut avoir pour l’autre. La morale suppose implicitement une réflexion permanente sur notre relation à l’autre. Est-ce que ce que cette action que je décide ne constitue pas une agression ou plus simplement une offense pour mon partenaire, mon voisin, mon collègue… ? Le principe de réciprocité implique que je respecte l’autonomie de l’autre autant que je souhaite qu’il respecte la mienne.
Ce sens de l’altérité n’est pas donné automatiquement par la conscience de l’existence de l’autre, il s’acquiert. Kahn considère comme « sens moral originel » les positionnements ethnocentriques de type tribal, depuis la bande du quartier, le gang jusqu’au cercle fermé des membres d’un parti ou des adeptes d’une religion, se caractérisant par une identification au proche, identification au même et non à la reconnaissance de l’autre semblable. Vécu comme une menace, il n’intègre pas cet autre-étranger à sa sphère familière. Les valeurs morales et la solidarité sont limitées au clan hors du partage des valeurs universelles. Passer de la morale primaire du groupe à la reconnaissance de la valeur de l’autre différent mais semblable a nécessité des millénaires. Ce développement humain grâce à l’accroissement de ses potentialités mentales et morales a permis de progresser dans l’idéal d’humanisation.
Axel Kahn pense en effet que l’accès à la pensée morale est concomitant à l’avènement de l’humanité. La prise en compte de l’autre, la conscience qu’il est indispensable à mon existence a été le moteur du développement des relations humaines et de l’épanouissement des potentialités inscrite dans ses gènes. Les relations intersubjectives ont permis l’activation des gènes préhumains et facilités l’exploitation d’un potentiel biologique latent. A partir du moment où je prends en compte l’existence et la pensée de l’autre, je lui reconnais les mêmes droits que les miens. En conséquence je développe des conduites dans le respect de son autonomie. Cette interrogation sur l’existence et les pensées d’autrui est donc à l’origine de l’humanisation de l’Homo sapiens et elle en est aussi la condition. Dans cette aspiration, la dignité est la qualité d’« une communauté humaine [qui] se fixe le devoir de respecter les êtres, y compris ceux qui sont dans l’incapacité de réclamer leurs droits. »
Cet évolutionnisme souriant que l’on espère garant de la continuité de l’amélioration de notre humanisation est tributaire de la haute considération en laquelle Kahn tient l’homme. Il lui octroie deux qualités supérieures indissociables : la liberté et la responsabilité. Tout être humain est soumis à des influences diverses : physiologiques, psychiques, sexuelles, culturelles, éducatives, événementielles… mais il possède les capacités de s’interroger sur ce qui fonde ses choix et ses actes et ainsi parfois de s’en émanciper : « Quelle que soit l’analyse de chacun sur cette énigme du libre arbitre, tous pourront se retrouver sur l’exigence éthique de faire le maximum pour desserrer l’étau des déterminismes, élargir le spectre des possibles et dégager de la sorte un espace où puisse s’épanouir la liberté ou du moins ce qui est ressenti comme tel. »[13]
Axel Kahn repère l’émergence du sujet dans cette matrice originelle, « ce rapport de l’un et l’autre, irréductibles l’un à l’autre mais indissociables l’un de l’autre [14]». En effet dès le jour où nous advenons ne sommes-nous pas constamment confronté à cette question : qui est cet autrui qui est pourtant mon semblable ? Comment se construit le petit d’homme ? Comment se reconnait-il comme sujet ? Par quelle médiation se situe-t-il dans la société des hommes ?
Le stade de la reconnaissance.
Arrêtons-nous sur le développement du petit d’homme tel que Jacques Lacan l’a présenté[15]. Les premiers mois qui suivent la naissance se caractérisent par une absence de conscience du corps propre, l’infans se vit comme une continuité du sein maternel. Ces six premiers mois sont marqués par l’angoisse en raison de la perception d’un corps morcelé. Comment, partant d’une situation vécue comme indifférenciée le petit d’homme va-t-il faire l’expérience de soi-même ?
Lacan se réfère aux travaux de Charlotte Bülher. Dans ses travaux sur le transitivisme enfantin (1927), elle rapporte des observations bien connues des éducateurs : telle cette scène d’un enfant qui pleure en voyant un camarade tomber ou cette autre de celui qui bat son camarade et dit avoir été battu ! Une période où il est constaté que l’enfant parle de lui à la troisième personne. D’autres observations illustrent cette ambiguïté initiale de la relation duelle, cette complexe confusion entre soi et l’autre : qui n’a pas assisté à ces jeux d’influence auxquels se livrent les enfants entre six mois et deux ans ? Soit deux sujets, le premier se donne en spectacle et le second le suit du regard, lequel est le plus spectateur ? Bien évidemment le premier, sinon quel intérêt aurait-il à son exhibition s’il ne s’appuyait pas sur ce qu’il prête au regard du second ? Le sujet confond « la partie de l’autre avec la sienne propre et s’identifie à lui. » C’est-à-dire que l’identification se fonde sur un sentiment de l’autre. C’est par cet effet en miroir que le petit d’homme réalise le sens de son unité corporelle. Ce moment bien connu est décrit par Lacan sous le nom de stade du miroir. Le petit enfant reconnait son image et le manifeste par un mouvement jubilatoire significatif. Il met son corps à l’épreuve et il observe ses mouvements et son environnement. Cette image révèle l’unité de soi-même et sort l’enfant du malaise lié à la perception du corps morcelé.
Ce passage comporte une ambiguïté qui en fait sa complexité. A ce stade le nourrisson n’a pas acquis la maîtrise de la marche, il est encore sous la dépendance de celui qui lui prodigue ses soins et cette image qu’il perçoit, par son unité, lui fait anticiper une maîtrise corporelle à laquelle il n’a pas encore accès : il n’est pas l’image qu’il voit. Cependant cette image qui n’est pas lui a une fonction constituante, car il s’identifie à cette image extérieure. C’est-à-dire qu’il se place dans le rapport à l’image de son semblable ou dans le rapport à l’image que lui renvoie le miroir, c’est par l’image de l’autre que le sujet accède au sentiment de soi. L’importance de ce passage tient au fait que cette image à laquelle il se confond restera inscrite et déterminera l’image qu’il veut donner de lui. Ainsi en sera-t-il de son désir qui sera toujours tributaire du désir de l’autre.
Ajoutons et c’est essentiel pour la question qui nous occupe, que pour que ce dispositif fonctionne, pour que le sujet accède à ce sentiment de soi, il lui faut une authentification : c’est par la médiation de la mère qu’il peut s’éprouver comme individu distinct. C’est le regard de la mère et les paroles qui l’accompagnent : « c’est toi Pierre, Paul, Jacques, un toi qui deviendra un c’est moi», qui lui permettront de prendre sa place dans la famille, puis dans la société.
Au-delà de la sphère familiale, l’enfant va connaître l’épreuve de la sociabilité. Si la relation duelle lui permet de s’identifier à son semblable, c’est une relation qui suscite en même temps de la concurrence et de la jalousie. Le camarade, ce petit autre devient alors un autrui, un tiers. L’enfant qui s’éprouvait jusqu’alors passivement dans le regard de l’autre, s’ouvre à présent à des échanges. Il met une intention en acte, il se met à l’épreuve dans cette relation de concurrence, dans les jeux conflictuels. C’est le moment où l’agressivité doit lui permettre de faire sa place au risque d’être nié. La qualité de ces confrontations aura un effet sur la nature des relations sociales que le sujet établira. Il s’agit d’un pas déterminant puisque l’enjeu n’est rien que le refus du réel, le repli sur une position mortifère ou au contraire une avancée qui sera couronnée par le complexe d’Œdipe. C’est le moment où l’intervention du père ou de quiconque occupe cette position de tiers permet à l’enfant de se désasujétir de la relation maternelle pour advenir comme sujet autonome. Il soutient implicitement cette affirmation : « tu es ma fille, tu es mon fils, je te reconnais comme tel. » Ainsi la résolution de l’Œdipe libère le sujet en lui donnant Nom et place dans la constellation familiale, c’est-à-dire le signifiant originaire de soi.
Ce cheminement décrit les différentes crises qui permettent au petit d’homme d’advenir en tant que sujet distinct autonome avec ce qui le singularise. Dans ce mouvement il acquiert « une conscience de plus en plus adéquate de lui-même »[16]. L’opération œdipienne bouscule les représentations archaïques disparates et le sujet accède à une perception homogène des sentiments qu’il a de son corps. L’intervention du père pondère les relations primaires empreintes d’avidité et de jalousie de l’enfant à sa mère et à son rival. Lacan utilise le terme chimique de floculation pour illustrer cette opération, c’est-à-dire quand des éléments suspendus dans une substance colloïdale s’agrègent pour former des flocons : «la nouvelle image fait ’’floculer’’ dans le sujet un monde de personnes qui en tant qu’elles représentent des noyaux d’autonomie, changent complètement pour lui la structure de la réalité. »[17] Dans le mode imaginaire, la réalité est constituée de représentations archaïques, éléments mal définis, indistincts, suspendus qui suscitent des affects primaires, la synthèse opérée par l’Œdipe permet au sujet de se percevoir comme entité distincte et de distinguer ces autrui autonomes. Dans la conséquence majeure ce passage instaure un nouveau rapport aux autres humains et à la réalité.
Nous constatons la complexité du processus qui permet à un sujet de s’éprouver comme soi-même, de se reconnaître comme tel, de situer l’autre et de s’ouvrir à ce tiers différent. Cette distinction n’est cependant jamais clairement et définitivement acquise. Ce soi-même est enraciné dans son rapport fondateur à l’autre, lui reste aliéné et brouille la perception de l’autrui autonome. L’affirmation de soi autant que la reconnaissance d’autrui s’annonce comme un travail jamais achevé d’interrogation sur la position que le sujet occupe et celle à laquelle il place ses semblables. L’étude phénoménologique de la reconnaissance nous offre un complément opportun propre à saisir les meilleures conditions possibles de mutualisation entre membres d’un collectif, en l’occurrence pluridisciplinaire.
Un parcours de la reconnaissance[18]
L’essai de Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance, est une enquête[19] passionnante qui met en parallèle la déclinaison lexicale du substantif « reconnaissance » et son corolaire « reconnaître » (chez Littré et Le Grand Robert) et la façon dont chemine le travail des philosophes sur ce concept depuis Descartes. L’orientation de notre atelier nous rend particulièrement sensible au constat d’« un renversement » au simple plan de la grammaire « du verbe reconnaître de son usage à la voix active à son usage à la voix passive : je reconnais activement quelque chose, des personnes, moi-même, je demande à être reconnu par les autres »[20] Remarque qui augure un renversement similaire au plan philosophique. De reconnaître à être reconnu Ricœur nous éclaire sur la question de l’altérité qui nous occupe. Le « je reconnais » peut être l’expression d’un sujet qui ne se reconnait que de lui-même, exerçant une maîtrise, un pouvoir sans partage. Dans ce cas, c’est lui qui a l’initiative, il ne demande rien à quiconque. La « demande d’être reconnu » introduit un tiers comme condition de réalisation de son attente. Elle suppose implicitement la place d’un autre hors duquel sa quête reste inassouvie. Le sujet ne se satisfait plus du seul écho de sa propre voix, il doit pour exister entendre cet écho dans la voix d’un autre. Dans ce cas ce n’est plus lui qui a l’initiative, et pour que son vœu ait une chance d’être exaucé il doit en passer par l’autre.
Paul Ricœur nous propose un parcours qui s’accompli en trois étapes : la reconnaissance au sens d’identification/distinction, la reconnaissance de soi et la reconnaissance mutuelle.
Dans les dictionnaires cités le sens initial de reconnaître, chevauche celui de connaître dont il est dérivé. A savoir : connaître c’est reconnaître quelque chose comme le même en faisant des comparaisons, en établissant des caractères communs déjà identifiés. Ou encore reconnaître comme identique à soi-même et non comme autre chose que soi-même. Cette action implique de distinguer l’un de l’autre. Pour Descartes reconnaître, c’est identifier, c’est appréhender une entité par la pensée qu’il s’agisse d’idées scientifiques, d’objets perçus, de personnes ou de Dieu. Il octroie à cette identification un statut de clarification, celui de distinguer, de séparer les choses entre le même et l’autre. Pour Kant, reconnaître c’est aussi identifier mais dans le sens de relier présent dans la définition du Grand Robert « saisir (un objet) par l’esprit, par la pensée, en reliant entre elles des images, des perceptions… » Kant inscrit cette opération de liaison dans la dimension temporelle. Depuis le moment de recevoir une information (sensibilité) à celui de la penser (l’entendement), c’est un acte fondamental de jugement.
L’auteur de la Critique de la raison pure tire les conséquences de ce pivot que constitue implicitement l’acte de jugement, qui le conduit à une véritable révolution copernicienne au plan philosophique : celle de l’introduction de la notion de représentation, qui implique la subjectivité. Ainsi résumée par Kant lui-même : « C’est que nous ne connaissons à priori des choses que ce que nous y mettons nous-même ».[21] Le philosophe institue ainsi une relation de référence entre sujet et objet. Cette sorte de souveraineté de la représentation est complétée par Husserl prenant en compte l’intentionnalité, cet inaperçu qui sous-tend notre rapport au monde et commande notre position de sujet.
La délicate distinction entre connaître et reconnaître, pierre d’achoppement de cette première définition du dictionnaire, se précise dès lors que nous analysons notre rapport aux objets usuels et aux personnes. Nous identifions les choses par leurs caractères spécifiques, nous établissons avec elles un rapport familier, confiant, dans ce qu’il suppose une permanence de ce que nous avons identifié. Les traits individuels des personnes sur lesquels s’appuie notre reconnaissance sont beaucoup plus aléatoires. Le vieillissement à l’épreuve d’une longue séparation est le meilleur révélateur de l’usure du temps sur les visages et sur les corps. L’identification est aisée si l’objet n’est pas soumis à des transformations, à des déformations qui le rendent méconnaissable.
La première étape du parcours de Ricœur concerne donc l’identification de quelque chose en général : l’un n’est pas l’autre, la permanence des qualités de l’objet garantit en principe la validité de cette identification, mais les méfaits du temps qui passe peuvent favoriser une méprise. La deuxième étape s’engage selon le même critère d’identification.
Le Cogito cartésien est vraisemblablement l’acte fondateur de la philosophie réflexive, il introduit le mouvement qui conduit via une reconnaissance de soi à une théorie de la reconnaissance mutuelle. Mais ainsi que l’annonce Ricœur « Le chemin est long pour l’homme « agissant et souffrant » jusqu’à la reconnaissance de ce qui est en vérité, un homme capable de certains accomplissements. »[22] L’auteur note que chez les Grecs la reconnaissance de la responsabilité est déjà clairement affirmée. Les personnages d’Homère sont de véritables « centres de décision » (expression empruntée à Bernard Williams), ils passent leur temps à s’interroger sur les actes qu’ils doivent accomplir, moyennant quoi ils ont le sens de leur responsabilité en particulier au regard de leur notoriété.
Il est intéressant de constater que cette reconnaissance de soi nécessite la présence d’un autrui dont le statut ne l’inscrit pas encore dans une reconnaissance mutuelle. A l’image de la scénographie du retour à Ithaque, lorsqu’Ulysse se fait reconnaître par sa nourrice, par son fils et même par son vieux chien, lui seul est l’objet de la reconnaissance, ses interlocuteurs n’ont pas le même statut que lui, d’autant qu’il est le maître qui vient reconquérir sa maison. Si ces autrui sont indispensables à la reconnaissance d’Ulysse, ils ne la partagent pas en retour.
Dans Ethique, Aristote corrèle sans ambiguïté la responsabilité morale et l’action. Nos actes, particulièrement nos vertus ne sont pas le fruit de la seule grâce divine ou de la chance, ils sont aussi tributaires d’une décision intentionnelle, condition indispensable à une reconnaissance de soi-même. Pour le dire trivialement, le bonheur ne tombe pas du ciel ! A Socrate affirmant que nul n’est méchant de son plein gré au prétexte de diverses causes extérieures qui peuvent intercéder, Aristote rétorque énergiquement que le méchant l’est de son plein gré : le sujet dispose en lui du pouvoir de décider de faire ou de ne pas faire.
Si nous sommes redevables aux Anciens d’avoir identifié une reconnaissance de la responsabilité du sujet, ils ne l’ont pas hissé au niveau d’une conscience réflexive de soi-même. Un déplacement reste à opérer qui met l’accent sur le sujet lui-même et pas seulement sur les composants de l’action. Dans ce qu’il nomme une phénoménologie de l’homme capable[23] Ricœur s’engage dans « une réflexion sur les capacités qui ensemble dessinent le portrait de l’homme capable », qui fait apparaître cette conscience – réflexive – de soi. A savoir que l’homme capable se reconnaît soi-même dans ses capacités (pouvoir dire, pouvoir faire, raconter, se raconter…). De cette exploration de l’autodésignation du sujet parlant, une constante s’impose : une parole prononcée par l’un est toujours une parole adressée à l’autre.
A la deuxième étape du parcours que nous propose Ricœur l’identification du soi se substitue au quelque chose de la première étape. L’opposition-identification entre l’un et l’autre de l’ordre d’un état de fait devient une opposition-concurrentielle subjective ouverte à la conflictualité. Le quelque chose acquiert à présent une consistance dans son caractère original de se reconnaître pour ce qu’il est (ipséité). Cette dimension existentielle où l’autre peut venir en opposition au soi nous introduit aux questions qui nous occupent : la pluralité, l’altérité et la réciprocité au cœur de la troisième étape. Avec cette question sous-jacente qui n’est rien moins que de savoir s’il existe des motifs originairement moraux au vivre ensemble.
On ne peut imaginer une meilleure entrée à cette dernière étape que la formule de méconnaissance originaire accolée par Ricœur à l’état de nature développé dans l’œuvre de Hobbes[24]. Selon ce philosophe, l’homme est un loup solitaire, sa piètre existence est livrée à « une guerre de tous contre tous ». En conséquence de quoi, la peur de la mort violente règle sa conduite, l’autorisant à user sans vergogne sa puissance pour préserver sa propre vie. Dans cette logique, l’impératif du vivre ensemble lui dicte un droit dit « de nature » délégué à l’état, un ensemble de lois qui ne sont que le prolongement de la préservation du pouvoir propre. L’état de nature signe clairement une méconnaissance originaire, en ce qu’elle recouvre ce stade de développement du petit d’homme décrit par Lacan, ou la relation à l’autre semblable est empreinte de concurrence et de jalousie et fait écho aux positionnements ethnocentriques de type tribal, analysés par Kahn. Le modèle de Hobbes n’a pas dépassé le stade de ces passions primitives, il est fixé à une relation en miroir sans tiers régulateur. Dans un déni de reconnaissance de ce qu’est le genre humain, il ignore l’altérité à savoir que chacun sait la réciprocité entre les hommes, « je n’agis jamais sans cette conscience que j’ai de l’autre ».
Le vivre ensemble peut-il se concevoir sur un mode apaisé, autrement qu’à travers un droit fondé sur la seule lutte individuelle pour l’existence ? Le concept d’Annerkennung (reconnaissance) de Hegel ouvre une page importante de la philosophie contemporaine sur la question de la lutte pour la reconnaissance. Il franchit précisément le pas décisif entre relation à soi et relation à l’autre en établissant par exemple une corrélation entre injustice et reconnaissance. Une simple observation suffit à nous en convaincre, celle de notre réaction d’indignation face à une injustice ! Par la prise en compte de l’autre, l’être singulier devient un être pluriel. La reconnaissance régule ce que l’injustice rend inégal. Hegel ouvre un mouvement qui consiste à passer d’un pôle individuel négatif vers un pôle intersubjectif positif, par exemple : au mépris fait face la considération. C’est alors le désir d’être reconnu qui prévaut à la réaction pulsionnelle primaire de la peur de la mort violente et la lutte pour la survie devient une demande de reconnaissance réciproque.
Dans les pas de Hegel, Axel Honneth[25] développe trois modèles de reconnaissance intersubjective, successivement du registre de l’amour, du droit et de l’estime sociale. L’amour recouvre ici, toutes les relations primaires (rapports érotiques, amicaux ou familiaux), « impliquant des liens affectifs puissants entre un nombre restreint de personne »[26] Le droit suppose quant à lui l’intégration de règles normatives dans lesquelles les membres d’une communauté se reconnaissent (notion d’un « autrui généralisé »[27]). Les relations d’estime entre sujets conditionnent enfin la solidarité sociale (éthicité).
Ricœur souscrit à ce développement mais ne s’en satisfait pas, dans la mesure où l’Etat est en définitive garant d’une éthique (éthicité), dans laquelle le « je » se dilue dans le « nous ». Et de constater en outre que de Hegel à Honneth ces avancées ne dissipent pas l’idée de lutte, héritière de l’état nature. Qui plus est dans le monde contemporain, animé par les lois du marché, existe-t-il encore des biens non marchands ? Il perdure en effet une catégorie de biens sans prix, lié à la vie sociale : la sécurité, la fonction d’autorité, les charges et honneurs, autant de signes de reconnaissance non marchands.
C’est dans l’exploration de ce qu’il appelle des « états de paix », que l’auteur poursuit sa quête. Il puise son inspiration dans un registre symbolique indépendant de l’ordre juridique ou des échanges marchands, à l’image de Socrate enseignant sans attendre de salaire en retour ! Dès lors s’opère une révolution où l’objet est accessoire au regard du geste et de l’esprit qu’il suscite entre donateur et donataire. La clef de l’énigme réside alors dans la mutualité même de l’échange entre protagonistes[28]. C’est précisément cette opération partagée que l’on peut nommer reconnaissance mutuelle[29]. La chose, le présent n’est qu’un prétexte, un support émanant du processus de reconnaissance.
Contrairement aux règles du droit et du circuit marchand, s’efforçant de garantir une équité entre les acteurs, le don et le contre-don ignorent cette équivalence de valeur entre les objets échangés, c’est le geste qui prévaut. Le contre-don n’est pas une obligation de rendre aux fins de rétablir un équilibre, il est une « réponse à un appel issu de la générosité du don initial.»[30] Et Ricœur y insiste pour y donner toute son importance : « C’est sur la gratitude, j’y reviens, que repose le bon recevoir qui est l’âme de ce partage entre la bonne et la mauvaise réciprocité. »[31] Tel un moment de grâce, la gratitude vient clore le beau parcours offert par Paul Ricœur. Signature de la juste réception de l’acte, forme d’ultime reconnaissance, la gratitude vient dissoudre l’obligation de rendre.
La reconnaissance mutuelle à l’épreuve de la pluridisciplinarité
De la philosophie morale d’Axel Kahn à la phénoménologie de Paul Ricœur en passant par la théorie psychanalytique de Jacques Lacan, nous constatons d’évidentes corrélations. Depuis un state initial d’indifférenciation jusqu’à ce mouvement jamais achevé de reconnaissance de l’autre semblable. Cette exploration peut-elle nous aider à résoudre la question qui nous occupe : celle de concevoir des modalités d’échange qui concourent aux meilleures conditions possibles de la vie d’un collectif ? Nous l’avons compris, c’est au pluriel qu’il convient de parler de parcours, parcours de l’identification, parcours de l’altérité et parcours de la mutualisation, tant il est vrai que par-delà leurs interdépendances, chacun s’offre déjà comme un chemin singulier à couvrir pour lui-même.
Détournons le propos pour le mettre à l’épreuve triviale de notre collectif pluridisciplinaire.
L’expérience de la vie d’une équipe, autant que celle d’un groupe d’équipes réunis en partenariat, est révélatrice de l’omniprésence de la question de la reconnaissance. Manque de reconnaissance du travail de certains professionnels, méconnaissance des missions des partenaires, difficile mutualisation des expertises. Connaissance, méconnaissance, reconnaissance sont les constantes exprimées dans le travail de terrain.
Nous donnons notre priorité à la claire identification de chaque protagoniste : bien connaître le service dans lequel chacun œuvre, savoir exactement de quelle place il parle. Deuxièmement, avoir une bonne connaissance du réseau partenarial dans lequel chacun va interagir, bien distinguer les missions respectives des uns et des autres. Enfin, troisièmement instaurer le cadre de la rencontre entre partenaires, à savoir faire vivre l’altérité professionnelle, comment se présenter à l’autre et permettre à l’autre de se présenter. Ainsi peut-être aurons-nous réuni les meilleures conditions possibles de l’échange !
« La reconnaissance mutuelle peut se résumer comme une lutte entre la méconnaissance d’autrui en même temps qu’une lutte pour la reconnaissance de soi-même par les autres. »[32] C’est sur le constat de cette dissymétrie originelle que nous voulons conclure. Le philosophe a bien sérié les limites que des professionnels du terrain engagés dans la réflexion pluraliste éprouvent, à savoir le caractère indépassable de cette lutte « interminable »[33] De méprises en malentendus la méconnaissance n’est jamais dissipée et c’est le défi posé à tout collectif que de se colleter cette implacable réalité. Forts de la conscience de ce réel, ne peut-on pas empreinter une sente qui laisse poindre une clarté ?
Comment rendre ce parcours fréquentable ? Dans cette réflexion sur la pluridisciplinarité, nous sommes particulièrement sensibles au fait qu’il ne saurait y avoir de reconnaissance de soi sans identité clairement définie des acteurs. Si ce premier pas introduit à une reconnaissance de soi, cette dernière suppose ce mouvement autoréflexif et hétérororéflexif perpétuel par lequel nous nous reconnaissons une responsabilité dans le choix et les conséquences de nos actes. La réflexivité ne s’offre-t-elle comme un outil propre à résorber la conflictualité inhérente à toute expérience collective et à ouvrir à la créativité ?
Et de tendre ainsi vers ce que j’ai nommé des « états de grâce ».
Alain Depaulis
Bibliographie :
CASSIN Barbara, La nostalgie. Quand donc est-on chez soi ? Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2015
HOBBES Thomas, Léviathan, Folio essais, Ed. Gallimard, 2000
HONNETH Axel, La lutte pour la reconnaissance, folio essais, Gallimard
KAHN Axel, GODIN Christian, L’homme, le Bien, le Mal, Pluriel, Hachette Littérature
KAHN Axel, Un type bien ne fait pas ça… . NIL éditions, Paris 2010
KAHN Axel, Raisonnable et humain ? Nil éditions, Pars 2004
KAHN Axel, Être humain, pleinement, Les essais, Stock, 2016
LACAN Jacques, « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu », Autres Ecrits, Ed. du Seuil, Paris, 2001.
LACAN Jacques, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je », Ecrits, Ed. du Seuil, Paris, 1965
LACAN Jacques, « Propos sur la causalité psychique », Ecrits, Ed. du Seuil, Paris, 1965
MANDELA Nelson, Un long chemin vers la liberté, Fayard, 1995
RICŒUR Paul, Parcours de la reconnaissance, Gallimard, Folio essais.
STENGEL Richard, Les chemins de Nelson Mandela, 15 leçons de vie, d’amour et de courage, Ed. Michel Lafon, Pocket,
Références :
[1] CASSIN Barbara, La nostalgie. Quand donc est-on chez soi ? Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2015, p.132
[2] STENGEL Richard, Les chemins de Nelson Mandela, 15 leçons de vie, d’amour et de courage, Ed. Michel Lafon, Pocket, Chapitre 8, Connaître son ennemi.
[3] MANDELA Nelson, Un long chemin vers la liberté, Fayard, 1995, p.507
[4] MANDELA Nelson, Id. voir p.496 sa rencontre avec Jimmy Krüger, le ministre des Prisons.
[5] Cette présentation de la pensée d’Axel KAHN se réfère à : KAHN Axel, GODIN Christian, L’homme, le Bien, le Mal, (HBM) Pluriel, Hachette Littérature et à KAHN Axel, Un type bien ne fait pas ça… (UTB). NIL éditions, Paris 2010
[6] Kahn : « L’hominisation est le processus qui a abouti à l’apparition et à l’évolution biologique des différents primates du genre Homo (…). En revanche je réserverai le terme d’humanisation à l’acculturation d’un homme interagissant avec les autres au sein d’une culture humaine, phénomène indispensable à la mise en place de l’éventail des capacités mentales propres à notre espèce. » Raisonnable et humain ? Nil éditions, Pars 2004 p. 73
[7] UTB. p.43
[8] HBM, p.53
[9] HBM, p.61
[10] HBM, p.70
[11] HBM, p.66
[12] HBM, p.65 & UTB, p. 65
[13] UTB, p. 241
[14] KAHN Axel, Être humain, pleinement, Les essais, Stock, 2016, p. 31
[15] Ce sous-chapitre fait référence aux textes suivants :
LACAN Jacques, « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu », Autres Ecrits, Ed. du Seuil, Paris, 2001.
« Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je », Ecrits, Ed. du Seuil, Paris, 1965
« Propos sur la causalité psychique », Ecrits, Ed. du Seuil, Paris, 1965 (référence à Charlotte Bülher, p.180)
[16] LACAN Jacques, Propos sur la causalité psychique, Ecrits, Editions du Seuil, Paris, 1966, p.182
[17] Idem
[18] Le développement de cette partie se réfère à ‘’Parcours de la reconnaissance’’ (PR) de Paul RICŒUR, Gallimard, Folio essais.
[19] Enquête ou investigation, c’est ainsi que Ricœur nomme son essai.
[20] PR p.13
[21] PR p.97
[22] PR p.119
[23] Ce bref aperçu de la thèse de Ricœur peut être complété par une lecture des chapitres : Une phénoménologie de l’homme capable, La mémoire et la promesse, Capacités et pratiques sociales, p.149-236 in Parcours de la reconnaissance.
[24] HOBBES Thomas, Léviathan, Folio essais, Ed. Gallimard, 2000
[25] HONNETH Axel, La lutte pour la reconnaissance, (LR) folio essais, Gallimard. Selon ce philosophe, une société ne change pas uniquement sous l’effet de nouveaux impératifs gestionnaires (organisation administrative, forces financières…) ou de la lutte des classes, elle change aussi sous l’effet de besoins insatisfaits de reconnaissances qui engendre de nouveaux droits, de nouvelles règles collectives nouvelles.
[26] LR p.161
[27] LR p.183
[28] PR p.365
[29] Ricœur réserve le terme de mutualité, aux échanges directs entre les acteurs, par contraste à réciprocité, impliquant un ordre social, juridique ou marchand.
[30] PR p.374
[31] PR p.375
[32] PR p.394
[33] Ricœur emprunte ce mot « interminable » à la psychanalyse, dont Freud pointait de n’être jamais achevé.