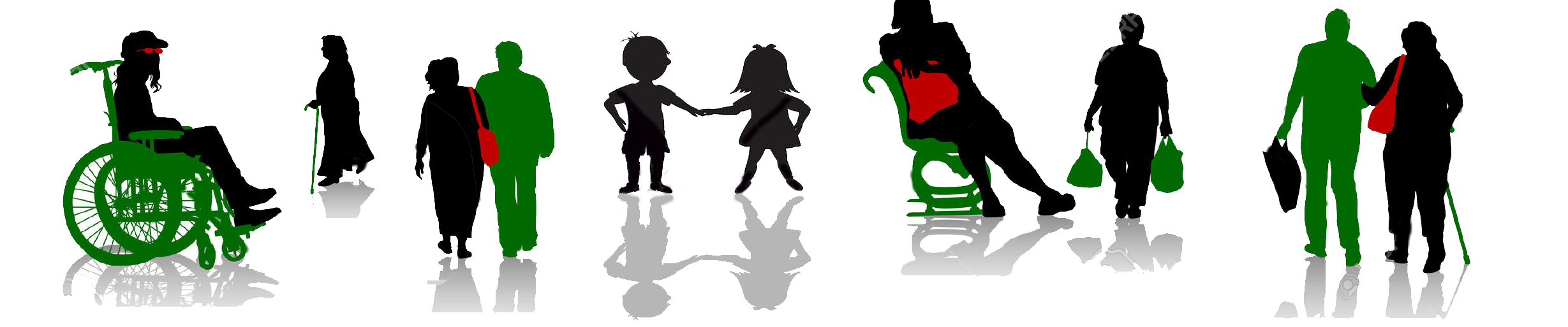DE L’USAGER A L’USAGEANT[1]
« Les médecins comprendront-ils jamais que rien n’est aussi difficile que de nommer ce qui ronge sourdement
que de mettre des mots sur l’innommable.
Trop flou, trop confus. Ils réclament de la précision. Alors leur dire quoi ?
Que ça vous titille dans le lobe temporal médian, vous savez, le long de la scissure rhinale,
du côté de l’hippocampe, en fait juste en dessous, dans le cortex entorhinal ?»
Pierre ASSOULINE, Golem[2].
Nous avons mis en évidence que les praticiens, quelques soient leur profession, partagent le même objectif : celui de la sécurité du patient, celui du bien-être de la personne vulnérable. Ce constat nous invite à réinterroger cette place d’usager, à reformuler sa position dans un système qui au prétexte de sa santé physique et psychique, de sa protection sociale tend encore trop souvent à décider en son nom. Il s’agit de lui permettre d’être réellement présent aux soins qui lui sont dispensés, de tendre vers une position de sujet et d’y assumer sa part de responsabilité, au niveau d’expertise qui est aussi le sien. Le guide OMS ne déclare-t-il pas que « le patient est une précieuse source d’information, étant le seul membre de l’équipe à être présent à tout moment au cours des soins. Il est aussi celui qui connaît le mieux son ressenti face à la maladie ou à son problème de santé. »[3] ?
Mais est-ce si simple que cela d’être acteur de ses soins ?
L’avènement du patient-expert[4]
Dans la deuxième moitié du XXème siècle l’accompagnement des malades chroniques a fait prendre conscience aux personnels de santé de l’importance de la contribution du patient à ses soins. Elle a permis de l’impliquer dans le suivi thérapeutique et d’y inclure également sa famille. La responsabilisation du malade se révélait un véritable atout dans le traitement de la maladie. Ce constat a favorisé une transformation sociologique majeure de l’exercice médical. Dès 1984, le sociologue britannique Armstrong expliquait combien le point de vue du patient est essentiel pour les médecins en tant qu’une « technique dont la médecine a besoin pour éclairer les espaces sombres de l’esprit et des relations sociales. » Par-delà l’apport thérapeutique donné par le patient acteur, le vécu subjectif et social du malade est donc déjà lui-même reconnu.
Parallèlement se développent les projets « d’éducation pour la santé », sous l’égide en France du CFES (Comité Français d’Education pour la Santé), puis de l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé). La vocation est ici délibérément pédagogique, elle consiste à transmettre des informations aux patients et des recommandations préventives aux citoyens. Les critiques des sociologues soulignent que cette instance tend à privilégier les données médicales, technologiques et procédurales de la gestion de la maladie, minorant les aspects psychologiques et sociaux. Dans ce schéma, le modèle médical scientifique et technique traditionnel perdure. Malgré ces réserves, l’éducation des patients constitue un progrès vers un statut de patient responsable.
Dans les années 70, c’est au mouvement féministe américain Our Body Ourselves que l’on doit la revendication la plus radicale d’un changement de statut de l’usager, s’adressant aux experts : « …vous êtes assurément les experts de Ma Maladie mais en aucun cas ceux de Mon Existence. JE suis l’Expert de ma propre existence. Donc discutons puisque c’est de moi dont il s’agit. » Ce message revendiquant cette place de patient-expert est repris par divers mouvements dont les activistes du sida. En Grande Bretagne le patient-expert est reconnu officiellement dans la santé publique. Le patient-expert devient une réalité dans le traitement de maladies telles que le cancer. Il est parfois l’objet de prolongements par des groupes activistes : expert de telle ou telle maladie, jusqu’à constituer des groupes de pression… On ne s’étonnera pas que le patient-expert soit particulièrement courtisé par les laboratoires pharmaceutiques !
De son côté le corps médical ne reste pas indifférent au vécu du patient et aux interrelations médecin/malade. Avec son ouvrage Le médecin, son malade et la maladie[5] (1955), le psychanalyste britannique Mickael Balint ouvre un champ inédit et fécond de réflexion sur de la pratique du médecin. Le groupe Balint qu’il initie, ne dispense pas un enseignement, il n’est pas un séminaire de cas cliniques, il ne soigne pas les soignants. Son objectif est l’analyse de la relation médecin-malade, il aide le praticien à mieux écouter et mieux aider son patient. Le groupe Balint accorde une grande importance à la subjectivité du malade, à ses émotions mais sans négliger celles du soignant et leur incidence sur le soigné. Les membres du groupe apprennent également à identifier les faits de l’inconscient qui agissent à l’insu du praticien : non-dits, actes manqués… La pratique des groupes Balint s’est généralisée à de nombreuses professions en particulier dans le médico-social. Son principe est à l’origine des supervisions et des analyses des pratiques si répandue aujourd’hui. Dans son intention, d’écouter le patient, d’être attentif à son ressenti, d’être vigilant à ce qu’on lui transmet, c’est une transformation de la pratique médicale qui s’annonce.
Le patient partenaire
Parallèlement à ce statut d’expert, une autre construction se dessine tant au niveau médico-social que médical : celle de l’usager/patient partenaire. La France a connu un certain nombre d’épreuves qui ont profondément ébranlé la confiance des citoyens aux experts : tel le scandale du sang contaminé ou celui des hormones de croissance. Dans un autre registre, la culpabilisation des mères d’enfants handicapés a eu des conséquences particulièrement douloureuses au plan humain et jeté un regrettable discrédit sur la psychanalyse et les consultations médico-psychologiques. La perte d’autorité de l’expert favorise une revendication à d’avantage d’échange et de partage avec l’usager.
Lors de la cinquième mandature du Conseil supérieur du travail social Jacques Ladsous[6] (dont on déplore la perte cette année), présidait un groupe de travail : L’usager au centre du travail social, au sous-titre éloquent : De l’énoncé des droits de la personne à l’exercice de la citoyenneté. Conditions d’émergence de pratiques professionnelles novatrices. A quelles conditions, l’usager peut-il être conduit à s’exprimer en citoyen ? Lors de ces travaux s’est imposé le concept d’alliance entre professionnels (soignant, éducateur, assistant de service social… mais aussi médecins, magistrats, membres de l’administration…) et usagers. Il doit être exercé dans toutes les institutions. La notion d’alliance thérapeutique avec les parents est parfois utilisée dans les soins prodigués aux enfants (dans le cas de l’autisme par exemple). L’alliance se caractérise par une pratique de la posture, décrite comme une attitude qui implique à la fois le corps et l’esprit, déclinée à tous les acteurs. La posture a pour objectif de rompre le rapport dominant-dominé pour y substituer une relation de fondée sur le partage et l’échange. Pour Ladsous, l’accompagnement c’est le partage.
L’expérience de la posture est étudiée sur le moment de la rencontre qu’il s’agisse de sujets à accueillir que de sujets sans demande vers lesquels il faut aller (tels la prévention spécialisée, l’urgence sociale…). Ce temps préliminaire à tout projet engage un processus nécessairement variable selon les personnes. « Le temps n’est pas prévisible au départ : le temps de comprendre, de choisir, d’associer, de construire. » (p.41) A l’issue de cette réflexion collective, le groupe a retenu onze recommandations qui loin d’être un catalogue de bonnes pratiques, s’efforce de susciter de nouvelles modalités d’échanges entre usagers et professionnels. Elles sont structurées selon trois axes :
- Celles qui concernent tous les niveaux de l’action : de la décision, de la prescription à la mise en œuvre et à la réception.
- Celles qui concernent particulièrement les pratiques professionnelles et les organisations dans lesquelles elles s’exercent.
- Celles qui concernent les formations adaptées des intervenants sociaux.
Ce projet n’est pas sans évoquer le dessein de Pluriact, nous y trouvons des intentions majeures communes : celle d’identifier les conditions permettant à l’usager d’entrer dans un échange authentique avec les professionnels, celle d’instaurer les conditions d’un échange cohérent entre les professionnels. Jacques Ladsous est particulièrement attaché au croisement des savoirs. Nous y percevons enfin cette exigence éthique hors de laquelle la relation professionnelle reste lettre morte.
C’est vraisemblablement dans le champ médical que cette mutation s’exprime avec le plus d’acuité. Le spécialiste naguère auréolé d’un savoir inaccessible au commun des mortels est aujourd’hui consulté par un patient nourri de toutes les connaissances que lui offrent les réseaux sociaux, au point de détenir parfois des informations encore inconnue du professionnel ! Le modèle relationnel du colloque singulier s’en trouve profondément modifié. Le malade ne se contente plus de recueillir la docte parole de l’expert et d’appliquer en confiance la prescription, le savoir dont il dispose lui permet d’entrer dans un échange critique avec le médecin. Dès lors la relation médecin-patient s’orienterait vers une relation partenariale, fondée sur la délibération.
C’est cette mutation que Jean-Philippe Pierron[7] se propose d’étudier : « L’enjeu est de chercher à penser les conditions d’une relation partenariale malade-patient… » (p.44). Le développement du philosophe s’appuie d’abord sur la construction du concept de patient à travers l’élaboration de l’hôpital et l’avènement de la médecine clinique. Si la maladie est inhérente au vivant, l’état de « malade » a dû répondre à certains critères pour être reconnu : la maladie est un fait individuel et non un phénomène de masse, elle n’est pas nécessairement mortelle… Cependant ce statut de malade n’en fait pas pour autant un patient. Il faudra beaucoup de temps pour que le malade advienne comme patient, existant par-delà la maladie comme individu, exprimant une demande d’aide et acteur de ses soins. Un statut entériné par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : le patient devient un usager du système de santé. L’expansion d’une médecine moléculaire, la numérisation du vivant avec pour conséquence la réification des malades conforte cet acquis au point de voir les patients s’organiser en associations d’experts de leur maladie.
La relation médecin-patient est dès lors encadrée par le droit. J-P Pierron développe les possibles risques de perversion de l’acte médical : colloque singulier exposé à devenir un espace polémique avec un patient très informé, avec un patient méfiant voire procédurier… Ainsi que le remarque l’auteur ne risque-t-on pas de voir le médecin se démettre de sa responsabilité et renvoyer le malade à la revendication de son autonomie ? Ne risque-t-on pas alors de voir le patient contraint d’assumer seul le poids de la maladie ? Dans une autre perspective, ne risque-t-on pas de voir le patient prétendre assumer ses soins de son propre chef en picorant ci ou là des informations médicales plus ou moins fiables ?
Si le philosophe salue la fin de l’ère du patriarcat médical, il n’en est pas moins conscient de la menace de l’avènement d’un « patient décideur et consommateur de soins. ». Dans sa recherche d’un juste équilibre entre malade, maladie et soignant, il pose l’hypothèse « que la naissance des droits du malade (…) signale moins la mort de la relation de confiance patient-médecin que la reconfiguration de ce rapport, la régulation par le droit se substituant à une régulation par ce que l’on appelait autrefois les ’’bonnes mœurs[8]’’.» (p.43)
Dans son développement J-P Pierron s’appuie sur le constat de la singularité de la rencontre, fondée d’une part sur la plainte d’une personne en souffrance adressée à qui est sensé l’entendre et y répondre. Et d’autre part celui qui en est dépositaire et de ce fait responsable à son égard. Dans la relation traditionnelle, le médecin endossait une responsabilité de type patriarcale, au nom de son savoir et de son pouvoir, il se concentrait sur le seul objet de soins, ignorant tout ce qui constitue l’être et l’univers de son patient (tels ses croyances, sa religion, sa morale, ses mœurs…). L’avènement du droit du patient l’oblige aujourd’hui à intégrer que l’objet de soins et aussi un sujet de droit. L’autorité médicale ne peut plus s’abstraire du monde de son patient, l’acte médical n’est plus le domaine réservé de l’expert ! La loi assurerait dès lors dans la relation médicale le rôle de tiers-arbitre dévolu naguère aux ’’bonnes mœurs !
Comment concevoir l’acte médical dans cette nouvelle configuration ? Le médecin ne prétend plus aujourd’hui détenir de certitude il ne prétend pas d’avantage imposer une prescription. Il est ouvert à l’échange avec le patient auquel la loi reconnait d’ailleurs le droit à l’information. Dans cet esprit, la décision thérapeutique est prise en commun, ce que Pierron nomme la décision partagée. Là se pose une question majeure, qu’est-ce qui construit la décision, surtout lorsqu’elle prétend être partagée ? Cette décision nécessite un processus qui demande de l’évaluation, de l’information, de la délibération, de la compréhension et enfin une conclusion pour l’action. Le praticien sait bien qu’il n’est pas évident de transmettre une information à un patient en état de vulnérabilité habité par ses inquiétudes. C’est un cheminement clinique particulier dont l’auteur ne cache pas la complexité. Il est à construire au cas par cas, en sachant que les patients ne sont pas identiques dans leur souffrance, ils ne sont pas égaux dans la maladie…
Le service de soins à la personne vit une profonde transformation, J-P Pierron propose « trois types d’obligations normatives : au patient, la réplique de la sollicitude dans la confiance ; au malade sujet de droit, la réplique de la justice dans le contrat de soin ; à la condition humaine d’homme vulnérable, la réplique de la solidarité humaine dont le médecin est un des porte-parole. » Confiance, justice et solidarité, un trépied qui vient sceller cette relation patient-médecin.
L’élaboration de cette relation partenariale est en effet l’objectif du philosophe, son argumentaire tend à rééquilibrer la relation patient-médecin par la garantie des droits donnés aux usagers. Moyennant quoi on perçoit le risque de faire du Code des droits du malade un guide quelque peu rigide de la conduite médicale. N’est-ce pas un leurre et n’y-a-t-il pas un danger d’octroyer à l’absolu fictionnel du droit le pouvoir de légiférer sur la réalité hétérogène de la clinique[9]. Jusqu’à quel point peut-on légiférer sur un exercice humain aussi complexe ? L’acte médical doit évidemment être encadré par la loi, mais quid d’une médecine réduite à un rapport contractuel, hantée par la figure du juge ?
Arrêtons-nous un instant sur cette notion de contrat aujourd’hui si répandue : contrat de projet de vie, contrat d’insertion, projet personnel individualisé… Dans la logique managériale, le contrat favoriserait la responsabilisation du citoyen en garantissant son engagement. Moyennant quoi, la réalisation du contrat ne dépend plus que du degré d’investissement de l’usager, sans qu’il soit tenu compte de tous les aléas psychiques (affectifs, cognitifs…) et sociaux dont l’aboutissement est tributaire. In fine l’usager se trouve seul responsable de son échec et par là même coupable de manquement à son engagement ! Dans sa réflexion sur l’éthique en travail social, Philippe Merlier[10] analyse bien cette nouvelle servitude douce qui se généralise pernicieusement. La vertu émancipatrice que l’on ne se prive pas d’accoler au terme de contrat se révèle tout bonnement un leurre. Peut-on gagner son autonomie par des liens qui contraignent ? L’autonomie ne s’acquiert que par un cheminement patient qui permet d’affronter et dépasser pas à pas les obstacles et non en restant fixé coûte que coûte sur l’objectif que l’on a signé et que l’on doit tenir à tout prix.
Dans son développement J-P Pierron nous apporte de nombreux éléments propres à repenser la relation entre l’usager et le professionnel. Par-delà la sphère médicale, nous pouvons aisément les partager dans tout accompagnement de la personne vulnérable, affectée au plan biologique, psychique et social. Ce sont des acquis que nul ne peut contester, puisqu’inscrits dans la loi : l’expert ne peut plus se retrancher derrière son savoir et son statut, l’usager/patient a une compétence, il doit être impliqué dans le diagnostic et la décision, l’usager a des droits. La nature même d’une relation qualifiée de partenariale mérite néanmoins un examen. Elle exprime cette quête d’un statut paritaire : usager et professionnel délibérant ensemble des symptômes, du diagnostic et du protocole thérapeutique, éducatif ou rééducatif. Cependant, on ne mesure encore pas très bien les conséquences de cette mutation de l’acte médical au niveau même de la qualité des soins. Sur quelle base s’inscrit la relation intersubjective entre le soignant et le soigné ? Quels sont les présupposés qui président à cette nouvelle relation qualifiée naguère de relation d’aide ? Ne risque-t-on pas de dissoudre ce qui est au fondement de la rencontre entre le patient et celui auquel il adresse sa demande : la confiance.
Paradoxalement, le développement de J-P Pierron nous livre toutes les réserves que l’on peut opposer à l’application de ce terme. Lui-même ne ponctue-t-il pas régulièrement son argumentation par le rappel que le partenaire du médecin est quand même malade ! En effet la garantie du droit ne nous dispense pas du réel de la rencontre entre deux personnes qui ne sont pas sur le même plan : le premier est en souffrance, il demande de l’aide et par cette demande il présente sa faille au spécialiste. Il se place dans un rapport de subordination. Il reconnait au spécialiste le pouvoir d’apporter un soulagement à ses maux. Ainsi donc : ce qui institut la rencontre et qui la soutient de bout en bout, c’est cette adresse à un sujet supposé savoir… Tel est le réel de la clinique que l’on ne peut se contenter de banaliser même si le droit veille !
Si nous aspirons à une refondation de ce rapport, nous devons intégrer que cette asymétrie perdure tout au long de l’intervention et qu’elle gauchit inévitablement la relation interpersonnelle. Nous la constatons dans le temps du diagnostic, quelques soient les connaissances acquises par le patient, elles ne constituent pas une compétence professionnelle. Nous la constatons ensuite dans le temps de la délibération, le temps du patient n’est pas le temps du spécialiste, que l’on évoque la complexité des informations ou les perturbations inhérentes aux affects éprouvés qui conditionnent l’intégration des informations. Nous la constatons enfin dans le temps de la décision, Pierron le dit clairement : « pour le médecin, l’objet est un traitement pour un sujet ; pour le malade, l’objet c’est lui-même ! » Un autre élément ne doit pas être négligé : celui de la responsabilité, qui n’est pas engagée sur le même registre pour le professionnel et pour l’usager !
L’évolution de la société nous invite donc à repenser ce statut de l’usager/patient. Certains lui reconnaissent une position d’expert, voire d’expert de sa personne. Les connaissances très spécialisées qu’il peut avoir acquis tout le long de sa maladie, au point de pouvoir argumenter pertinemment avec le spécialiste, le témoignage indispensable qu’il peut donner de son vécu des soins, en font-ils un expert du protocole qui doit lui être dispensé ? D’autres dans le médical et dans le médico-social[11] lui préfère la notion de partenaire. L’usage du mot partenaire ne manque pas d’ambiguïté. Par son étymologie[12] il revêt d’abord un sens général de « personne qui partage une chose avec une ou plusieurs personnes » (1297), puis « d’associé », de compagnon, voire de complice. Son usage s’applique ensuite au commerce (1523), à la danse (1613), aux jeux et aux sports de compétition (1680) puis à l’un des époux. La langue française l’a enregistré au sens de coéquipier dans le vocabulaire du jeu et du sport et de cavalier pour la danse. Cet usage confère un caractère d’équivalence aux acteurs qui ne correspond pas à la réalité du rapport usager/professionnel. Enfin jusqu’à quel point peut-on considérer le patient comme un membre de l’équipe soignante ou de l’équipe éducative ? Qui ne connait pas ces apartés en coulisse hors de la présence de l’usager ? Certaines questions, certaines hypothèses apparaissent soudain dans le cours des échanges qui ne sauraient en effet être débattues en présence de(s) l’intéressé(s) au risque de le(s) déstabiliser inutilement ? Quel type d’alliance peut-on sceller ? Que peut-on partager ? Nous mesurons les limites de cette volonté de conjoindre ces deux positions irréductibles.
L’usageant
Le projet d’Atelier de la pluridisciplinarité, en acte, au service de la personne vulnérable (enfants ou adultes handicapés, atteints de maladies chroniques, en état de dépendance ou socialement marginalisés) nous invite à approfondir ce statut de l’usager. Notre démarche se donne pour cadre la clinique et l’éthique. En référence à la médecine, la clinique est l’acte qui est pratiquée au chevet du malade, par extension c’est l’étude des discours recueillis dans la rencontre entre un usager et un professionnel[13]. Par éthique, nous entendons cette exigence de s’interroger à tout instant sur la relation que nous entretenons avec l’usager, avec nos collègues en équipe et avec nos partenaires extérieurs.
Afin d’éviter une confusion en prétendant faire de l’usager un pair du spécialiste, nous devons nous appuyer sur la réalité clinique. Le patient reste le malade, celui qui est en demande, celui à qui les soins sont prodigués. Le patient est affecté dans son être, il n’a pas la distance du spécialiste, il ne saurait s’y substituer. En revanche cette relation est caractérisée par une position paradoxale. En effet, en béotien l’usager s’en remet au savoir spécialisé de l’expert dont il accepte d’être l’objet de soins, en cela c’est lui qui supporte l’acte curateur, ce qui n’est pas neutre. Mais il est simultanément un sujet disposant d’un savoir singulier que l’expert ignore. Un savoir combinant son vécu psychique intime à son vécu physique, un savoir inscrit dans son histoire individuelle, familiale et sociale.
Ainsi donc, la position de l’usager est profondément originale, le sujet est en attente de recevoir un savoir spécialisé qui ne peut se construire qu’en référence au savoir intime que lui-même apporte. C’est le scénario complexe qui s’offre à nous dans les soins prodigués aux personnes affectés sur plusieurs plans et qui livrent les éléments du diagnostic pluridisciplinaire qui orientent les soins. C’est aussi l’usager qui apporte le témoignage intime de diverses interventions sur son vécu, sur son être. De cette place de Sujet, il est le mieux placé pour dire s’il est en mesure d’assumer telle ou telle prescription, le cas échéant de la refuser, dans tous les cas de déterminer le fondement du protocole de soins ou du projet éducatif ou rééducatif.
Il occupe une position clef qu’il est indispensable de lui reconnaître, il est L’usager, Le patient et à ce titre-là son discours, prévaut pour deux raisons : celui de sa contribution à la construction du diagnostic et celui de la décision quant à l’application du protocole thérapeutique, éducatif ou rééducatif. Nous avons choisi de la nommer usageant pour clairement signifier la position d’acteur qui lui revient. Le terme usager, induit en effet une certaine passivité, le participe présent le fait advenir comme sujet, comme agent. L’usager est un consommateur de services, l’usageant est un acteur associé à la prescription.
L’introduction de ce néologisme a l’intérêt de nous faire mesurer la complexité du protocole qu’il suggère. Toute intervention médico-psycho-sociale est une expérience inédite, inaugurant à chaque fois une nouvelle situation professionnelle à nulle autre comparable. L’accompagnement de chaque personne vulnérable est une expérience unique qui ne peut se concevoir qu’à partir de son discours. Cette rencontre n’est possible que si le spécialiste suspend un temps son savoir pour s’ouvrir au savoir de l’usager. C’est une posture par laquelle l’expert signifie à celui qui le consulte qu’il détient un savoir sur lui-même, qu’il lui libère cet espace et le soutient dans ce mouvement d’investigation personnelle.
Dans cet esprit, l’usageant partage avec le spécialiste le questionnement diagnostique, l’analyse de sa situation et l’élaboration de la réponse, nourri de son ressenti personnel voire des connaissances qu’il a acquises sur ses maux. Ce n’est pas au médecin, ni au psychologue, pas d’avantage à un collectif réuni en synthèse de parler en son nom. Il ne suffit pas de donner une place à l’usager. Encore faut-il lui permettre de l’occuper avec ses propres critères. C’est cela l’inclusion.
Cependant ce savoir n’est pas posé à priori comme celui du spécialiste, il est un savoir vivant qui se découvre lors de l’expérience qu’il traverse. Au fil de l’intervention le patient se révèle à lui-même en même temps qu’il se révèle aux experts : « Je me casse une jambe, je suis immobilisé. Je découvre des muscles dont j’ignorais l’existence, je découvre la dépendance physique, je vois surgir en moi un imaginaire perturbant que je ne me connaissais pas. Une vulnérabilité inconnue se révèle à moi. »
Certes on écoute le patient, on tient compte de son avis, mais est-il si facile de permettre à celui qui est l’objet de soins(s) d’assumer une position de sujet ? Chacun sait qu’il n’est pas toujours aisé de faire saisir au spécialiste les maux qui le conduisent à consulter. A fortiori comment une personne malade, handicapée, vieillissante, par définition affaiblie, en position de dépendance, submergée par l’inquiétude voire l’angoisse, ne disposant que de peu d’informations spécialisées, peut-elle donner un avis circonstancié ? Ce constat soulève la question du consentement que l’on qualifie souvent d’éclairé. Le consentement éclairé est-il une soumission à des arguments que l’on n’a pas vraiment intégrés, une acceptation par résignation ? Comme le dit Philippe Merlier[14] : « Consentir suppose donc une décision libre, un acte conscient, autonome et éclairé qui ne soit pas un renoncement ni une soumission hétéronome. » Et de poursuivre : « Mais alors, comment aider l’usager à se décider par lui-même ? » (p.61)
Pour répondre à cette question délicate, il nous faut nous d’abord prendre en compte un parasite qui biaise l’échange entre l’usageant et le(s) spécialiste(s), c’est la temporalité. Le temps est une variable inévitable de la relation médecin-malade, professionnel-usager, le temps du spécialiste n’est pas le temps du patient. Chacun est soumis à une temporalité spécifique. Le spécialiste doit apporter sa réponse, le médecin est tenu à des impératifs, (concernant le malade et l’évolution de la situation, parfois d’urgence) à des impératifs techniques (matériels et humains…) à des impératifs économiques… et combien d’autres. A des degrés variables chaque corporation est tributaire de contraintes.
Dans ces conditions qu’en est-il du temps de l’usager ? Dans une étude éloquente, Les temps du cancer, Marie Ménoret[15], nous fait toucher du doigt cet abîme qui sépare à jamais le patient de l’expert. L’auteur montre l’irréversibilité de la rupture biographique que constitue l’épreuve du cancer parce qu’elle n’a pas de fin et qu’elle exclue toute normalisation. Le patient vit dans une temporalité empreinte d’une incertitude constante et ses préoccupations l’entraînent parfois bien loin de l’acte dont le soignant doit s’acquitter. C’est un temps nourri parfois de colère, d’énervement et d’impatience, mais aussi d’abattement et de résignation. Ainsi le patient est inquiet. A-t-il toujours les mots pour s’exprimer ? A-t-il eu les informations nécessaires, si tel est le cas, les-a-t-il assimilées ? Mesure-t-on le temps qu’il faut consentir à la personne intellectuellement affectée, afin d’entrer dans son code langagier et corporel ? Le temps du sujet c’est aussi celui de l’inconscient qui est à ce point indéterminable dans son assimilation des informations, via les circonvolutions de l’affectivité que ce n’est pas le moindre défi que de lui permettre de tendre vers une position éclairée et active. La première obligation de l’équipe est cependant de permettre à l’usageant de saisir le sens des interventions dont il est l’objet, afin qu’il puisse signifier lui-même comment il les éprouve.
Cette exigence soulève bien évidemment la question des limites de son application dans un grand nombre de cas : depuis les urgences médicales jusqu’aux personnes intellectuellement démunies, en passant dans les décisions de justice… Cette réserve que l’on objecte constamment mérite en effet d’être approfondie au cas par cas. Doit-on pour autant rejeter à priori ce cadre intersubjectif que nous suggérons et le considérer comme inapplicable, irréaliste ? Nous voulons objecter à cela que dès lors que l’on revendique d’occuper une position éthique, il n’y a pas de transaction possible. La position éthique ne se négocie pas, elle est la recherche en toute circonstance, pour toute personne de la réponse la plus juste.
Si nous voulons permettre à la personne handicapée de s’orienter, de donner un avis circonstancié, nous ne devons jamais négliger les questions suivantes :
– L’usager a-t-il les mots pour s’exprimer ?
– A-t-il les informations nécessaires, si tel est le cas, les a-t-il assimilées ?
– A–t-il pu libérer l’inquiétude inhérente à sa situation ?
– A-t-il bien pris la mesure des solutions proposées ?
Avec les différents protagonistes, le protocole pluridisciplinaire se déploie sur plusieurs plans, mais c’est la position du patient qui en garantit la richesse et l’authenticité. Avant toute action, l’expert doit avoir affirmé cette place centrale au discours de l’usageant, soutenu par des va et vient constants entre chaque décision, chaque intervention. Ils permettent que les questions se posent, que les réponses soient apportées et intégrées, que l’inquiétude voire l’angoisse se libère… C’est le discours de l’usageant qui donne le tempo et lorsqu’une intervention contraint d’accélérer le processus, il est indispensable que l’expert l’intègre au partage des données. La position de l’usageant est le point de référence de chaque expert ainsi que des experts entre eux.
Idéalement l’usageant doit être dépositaire du protocole de soin.
Illustration
Thierry, 10 ans, est reçu au SESSAD[16] depuis deux mois pour des problèmes scolaires persistants. La famille est venue s’installer en Limousin. Thierry est suivi dans un service de neuro-pédiatrie suite à un trauma crânien, survenu à l’âge de 5 ans. Il a été reçu au RASED et bénéficie d’une rééducation orthophonique au CMPP.
La problématique de cet enfant se révèle particulièrement compliquée. Elle laisse perplexe les intervenants. L’instituteur est démuni. Thierry est passif, le travail ne semble pas faire sens pour lui. Les interventions du RASED et du CMPP n’ont pas d’effet. Les examens médicaux ne livrent rien d’anormal. Dans le cadre du SESSAD l’enfant est inactif. Il a des connaissances mais doit être stimulé pour les exprimer. En groupe, il reste en retrait.
C’est dans ce contexte d’incertitude généralisée que ces observations sont présentées aux parents et à l’enfant. Il convient de remarquer que la perplexité ambiante est particulièrement propice à leur participation au questionnement.
Ils évoquent en premier lieu le traumatisme crânien : “C’est comme si ça avait bloqué son cerveau…” dit le père. La mère confirme : “c’était un garçon actif et depuis il n’a plus intérêt pour rien”. Des hypothèses psychologiques sont avancées. La mère pense que la peur d’être en échec peut expliquer ses problèmes.
Le psychologue demande à l’enfant s’il comprend les inquiétudes des adultes, il acquiesce. Il poursuit : “ton maître se demande si tu écoutes”, “pas trop” dit l’enfant. “Le maître trouve que tu es triste ! “, “est-ce que tu te trouves triste ?” Thierry acquiesce. Le père complète : “c’est un enfant qui parle pas”. La mère corrige : “oh avec ses cousins, il parle beaucoup ! “. Au moment de conclure, le père déplore que personne ne comprenne pourquoi son fils est comme ça. C’est le moment où la mère fait cette remarque : “Thierry est différent avec ses cousins, il est joyeux. Quand ils sont là pendant les vacances, il est très bien. Faut dire qu’avant on était toujours ensemble !” Et d’ajouter : “en y repensant, ce n’est pas depuis l’accident qu’il est comme ça, c’est depuis qu’on habite ici !” Et Thierry interrogé, de répondre, le visage éclairé qu’il ne se plaît pas ici et regrette où il était avant ! Il apparaît alors que l’enfant mais aussi ses parents s’adaptent mal. Ils n’assument pas la séparation d’avec leur famille et souffrent d’isolement.
Le problème n’est certes pas réglé, mais un élément important est apporté de la bouche de la mère. Cette illustration est caractéristique des situations que nous rencontrons par sa complexité avec des éléments médicaux, psychologiques, familiaux sur fond d’échec scolaire. Traditionnellement le patient consulte l’expert afin qu’il apporte une réponse à ses maux. Dans notre projet l’expert ne prétend plus détenir la docte parole salutaire. Dès le premier entretien l’usageant est positionné en acteur de la démarche, soutenu par la position de non-savoir des experts. Il contribue ainsi au diagnostic et à la recherche des remèdes appropriés à sa singularité.
Dans cette illustration les parents déclinent diverses hypothèses. Au delà du problème scolaire, l’accident est évoqué avec ses conséquences éventuelles au plan cérébral, puis se font entendre des prolongements au plan psychologique sur l’enfant lui-même, mais aussi sur la vie familiale, par la relation hyper protectrice qui s’est nouée entre l’enfant et ses parents. Enfin leur transplantation, qui apporte un nouvel élément et non des moindres : l’éloignement de la famille, qui se confirmera être un pôle affectif prépondérant provoquant une blessure aux conséquences imprévues sur le développement de l’enfant.
Cette démarche diagnostique associant usageant et experts est transposable dans tout protocole pluridisciplinaire au service de personnes en état de dépendance, handicapées, en situation de rupture sociale, atteinte de maladie chronique ou de maladie rare… Nous voulons pour exemple le service du syndrome Gilles de la Tourette à la Salpêtrière, l’équipe du Docteur Andréas Hartmann a adopté un protocole associant le patient à l’équipe dans la recherche diagnostique et thérapeutique.
Conclusion
La question du statut de l’usager est engagée depuis la deuxième moitié du XXème siècle, elle est l’expression d’un désir de liberté individuelle et de démocratie sociale. Dans cet esprit, au cœur de la dynamique de notre démarche, l’usager nous invite à repenser la pluridisciplinarité. Comment lui permettre d’advenir à cette place d’usageant ? Toute intervention auprès d’une personne vulnérable crée une situation unique entre un sujet en souffrance et les experts qui doivent y répondre. Elle doit toujours être conçue comme une expérience inédite, inaugurant à chaque fois une nouvelle rencontre professionnelle. De cette position d’usageant dans laquelle nous l’accueillons, il est notre guide pour mieux le servir. Par la substitution du terme citoyen par celui d’usageant, paraphrasons Bruno Latour[17] : à la docte parole de l’expert, du chercheur solitaire, nous substituons une expérience collective qui implique l’usageant au côté des experts. « Chaque citoyen partage avec l’expert la notion de protocole d’expérience collective. »
Alain DEPAULIS
Cet article a bénéficié des remarques éclairées de Philippe MERLIER, Alain MOLAS et Jean NAVARRO
Bibliographie :
ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, V. 14, 1137 b 26 – 27
BALINT Mickael, Le médecin, son malade et la maladie, Payot, 2003
CHAUVIERE Michel, L’intelligence sociale en danger. Chemins de résistance et propositions. Ed La découverte, Paris 2011
LADSOUS Jacques, L’usager au centre du travail social. Empan 4/2006, n°64, p. 36-45 Eres, Toulouse, 2006
LATOUR Bruno, Un monde pluriel mais commun, entretiens, Ed. de l’Aube
MARAQUIN Carine, Handicap : les pratiques professionnelles au domicile, Dunod, 2015
MENORET Marie, Les temps du cancer, Le Bord De l’eau Eds, 2007
MENORET Marie, D’où viennent les « patient expert » ? & Sources et ressources du patient expert. Billets accessibles sur le web, Février 2014
MERLIER Philippe, Philosophie et éthique en travail social, Presses de l’EHESP, Rennes, 2013
PIERRON Jean-Philippe, Une nouvelle figure du patient ? Les transformations contemporaines de la relation de soins, Sciences sociales et santé, 2007/2 (Vol. 25), p. 43-66, 2007
[1] Cet article reprend en partie le contenu de la communication prononcée au 1ER Congrès International des Acteurs de l’accompagnement, sous le titre « Accompagnés, accompagnants, tous chercheurs ! » CIMA 2015, Limoges, Le 9 avril 2015
[2] ASSOULINE Pierre, Golem, Folio, Gallimard, 2016, p.20-21
[3] Guide OMS 2011
[4] Cette partie doit beaucoup aux billets de Marie MENORET, accessibles sur le web : D’où viennent les « patients experts » ? & Sources et ressources du patient expert. Février 2014
[5] BALINT Mickael, Le médecin, son malade et la maladie, Payot, 2003
[6] LADSOUS Jacques, L’usager au centre du travail social. Empan 4/2006, n°64, p. 36-45, Eres, Toulouse, 2006.
Jacques LADSOUS est décédé le 16 avril 2017, à l’âge de 90 ans. Educateur, ancien vice-président du Conseil supérieur du travail social.
[7] PIERRON Jean-Philippe, Une nouvelle figure du patient ? Les transformations contemporaines de la relation de soins. Sciences sociales et santé, 2007/2 (Vol. 25), p. 43-66
[8] Par ’’bonnes mœurs’’ Pierron fait référence à l’héritage judéo-chrétien qui via la morale et la charité a longtemps fait office de tiers-médiateur entre le médecin et le malade.
[9] « …La loi est toujours quelque chose de général et qu’il y a des cas d’espèce pour lesquels il n’est pas possible de poser un énoncé général qui s’y applique avec certitude. » Aristote, Éthique à Nicomaque, V. 14, 1137 b 26 – 27.
[10] MERLIER Philippe, Philosophie et éthique en travail social. Presses de l’EHESP, 2013. Voir le chapitre 5. La contractualisation du social. P.51-54
[11] MARAQUIN Carine, Handicap : les pratiques professionnelles au domicile, Dunod, 2015 Voir le Chapitre 3. Le partenariat, c’est quoi ?
[12] REY Alain, Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1997
[13] CHAUVIERE Michel, L’intelligence sociale en danger. Ed La découverte, 2011, Voir le chapitre 6 Actes de métiers cliniques contre bonnes pratiques, p.209-233
[14] MERLIER Philippe, Philosophie et éthique en travail social, Presses de l’EHESP, Rennes, 2013. A lire plus particulièrement les chapitres 6 et 7 consacrés au consentement et à la décision, p.55-63
[15] MENORET Marie, Les temps du cancer, Le Bord De l’eau Eds, 2007 A consulter particulièrement la 3ème partie : La gestion de trajectoires conjecturales.
[16] SESSAD : Service d’éducation spécialisé et de soins à domicile.
RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique.
[17] LATOUR Bruno, Un monde pluriel mais commun, entretiens, Ed. de l’Aube p.36